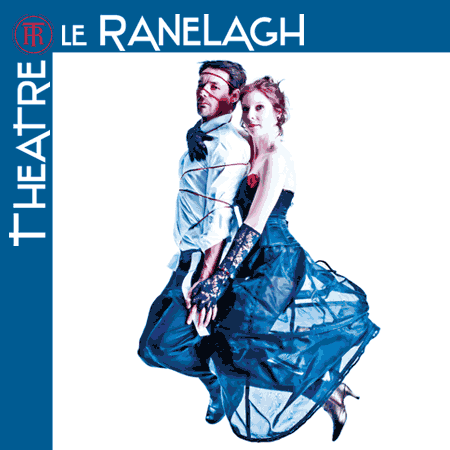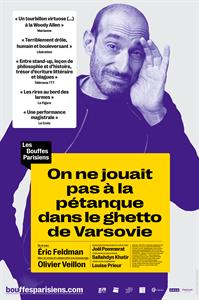Titanica
Titanica
- De : Sébastien Harrisson
- Mise en scène : Claude Duparfait
- Avec : Claire Aveline, Loïc Brabant, Bénédicte Cerutti, Gilles David, Jean-Marc Eder, Philippe Girard, Annie Mercier, Judith Morisseau, Hélène Schwaller, Cyril Texier
Titanica, la robe des grands combats, Edmund C. Asher, Londres, 1968.
L’art peut-il et doit-il fédérer ?
Extrait
Des bruits et de la fureur…
Le dernier jardin
Un souffle de métal dans la rumeur du monde
Occultation
Entretien avec Sébastien Harrisson
La reine, Virginia Ière d'Angleterre, a entrepris secrètement de se débarrasser de cadavres impurs qui souillent, selon elle, le sang de l'Angleterre alors qu'un poète de l'underground, DJ Lewis, lui envoie des lettres d'amour attisant son désir de femme.
Jimmy, un jeune américain empli de désir révolutionnaire, débarque sur les docks de Londres, sa volonté naïve d'action vient raviver les combats enfouis des squatters des docks qui sont menacés d'expulsion. Un moment de chaos, de confusion politique se prépare. Seule Titanica, œuvre d'art vivante, pourrait être une possibilité de conciliation.
Sébastien Harrisson, considéré comme l'une des voix les plus novatrices de la dramaturgie québécoise actuelle, interroge l'art et sa place dans la société.
Jimmy, seul en scène. Il met la caméra en marche.
JIMMY. J'ignore à qui je m'adresse. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que mes yeux qui vous regardent reflètent autre chose que la mémoire sanglante des siècles passés ? Autre chose que la peur ? J'ai peur. Peur de mourir avant d'avoir donné. Peur de m'éteindre avant que ma lumière ait brillé. Peur qu'un bateau m'emporte vers la terre fleurie des exilés. J'aurais aimé naître avec une cause, tracée au creux des mains, et qu'une gitane pourrait me dévoiler. Naître avec du fer à porter. J'ai peur de retourner chez moi, sans avoir rien trouvé ici, sans qu'un héros m'ait guidé. Retourner seul voguer sur cette mer, à la recherche de ce que nul autre ne connaît. Le seul combat qui m'appartienne : ma vie peuplée des vôtres.
Rideau.
Montréal, septembre 1997- Boston août 2001
" Ne trouvez-vous pas qu'il fait plus noir tout à coup ? " Isadora, séquence 2
Dans l'univers de Sébastien Harrisson, les hauts dignitaires laissent échapper malgré eux des aveux érotiques au beau milieu de leur discours officiel, tout en refoulant loin de leur pays des maux qu'ils disent innommables… Tandis que des rois impurs, assoiffés de vengeance, resurgissent du passé sous la forme de fantômes, et fomentent des attentats en faisant alliance avec de jeunes révolutionnaires américains venus chercher en Europe un combat de justice.
L'ordre du monde s'inverse. La marche du monde est celle du chaos. L'avenir est sombre, plein de fureur. Mais le présent ne démissionne pas.
L'écriture généreuse et foisonnante de Harrisson ne craint pas de se perdre dans les méandres de sa propre fiction, au risque de brouiller les pistes. Harrisson pose la question de la transgression dans le corps social en mêlant le politique et le sexuel, les amours contre nature et les troubles contre nature. Il s'interroge sur l'injustice mondiale, et sur le sens de l'œuvre d'art. Sur le passage des générations, et la nécessaire transmission de l'Histoire...
Ainsi, parfois, la pièce prend des allures de véritable kaléidoscope, de labyrinthe "affolé ". Mais toujours, Harrisson ne cesse de réécrire ce mot : combat. Comment agir ? Comment être actif au monde ? Comment s'inscrire dans l'Histoire ? Comment transmettre, ou comment défendre ensemble des principes de base d'une vie en société, qui aujourd'hui semblent remis en cause avec arrogance et mépris ?
Titanica : La nécessité du combat.
L'originalité et la complexité de Titanica - plus que de revenir sur le seul combat des années 70 et sur ses utopies, comme l'indique en clin d'oeil le sous titre de l'œuvre - résident dans sa volonté de faire se télescoper en permanence des paroles intimes à la grande Histoire (d'où parfois, le ton du documentaire…) : l'époque des années 68, mais aussi celle, plus lointaine, du règne convulsif et tragique d'Edward II, à travers lesquelles viennent s'entremêler notre désarroi et notre pessimisme contemporain… Une sorte de déflagration des Histoires. Un Big Bang.
Dans cette multiplicité des styles, la fiction qui se déploie, non sans humour, prend bientôt des allures d'épopée tragique : des êtres de chair et de sang que tout sépare, vont se retrouver plongés au même instant, dans un moment d'Histoire "anormal" et démesuré, sans paroles communes. C'est à cet endroit sans doute, que l'œuvre est la plus inquiétante et la plus passionnante.
Quand j'ai découvert la pièce au comité de lecture du Théâtre National de Strasbourg, je fus saisi par l'épilogue, la séquence XXX, où Jimmy, le jeune américain révolutionnaire, se retrouve seul avec une caméra en main. De quel côté est-elle tournée ?... Harrisson fait tomber le rideau, puis inscrit : " Montréal, septembre 1997- Boston août 2001."
Quelques jours seulement avant le chaos de septembre.
Claude Duparfait, au cours des répétitions, août 2004
Je parcours ce jardin,
main dans la main avec mes amis qui sont morts —
le vieil âge est tombé si tôt sur ma génération pétrifiée —
ils sont froids, si froids, et morts dans un tel silence.
Les générations oubliées ont-elles crié
ou ont-elles sombré avec résignation,
protestant, timides, de leur innocence ?
Je ne trouve pas de mots,
ma main tremblante ne peut exprimer ma fureur.
Ils sont froids, si froids, et morts dans un tel silence.
La main dans la main à quatre heures du matin,
au tréfonds de la ville sur laquelle tu dormais,
jamais ne retentit le doux chant de la chair.
Ils sont froids, si froids, et morts dans un tel silence.
Matthew baisa Mark baisa Luke baisa John
qui fut étendu sur la couche où je m’étends,
chantez ce chant et que vos doigts s’effleurent encore.
Nous avons froid, si froid, et mourrons dans un tel silence.
Mes giroflées, mes roses, mes violettes bleues,
doux jardin de plaisirs défunts,
Reviens, veux-tu, l’an prochain.
J’ai froid, si froid, et meurs dans un tel silence.
Salut les gars, salut Johnny,
Salut, bonne nuit.
Derek Jarman
dans Le Dernier Jardin, Éditions Thames & Hudson, 2003
Il aime les contrastes, ses personnages sont passionnés, il cherche la beauté des bas-fonds obscurs auxquels il donne un lyrisme mélancolique plein de grandeur : Sébastien Harrisson, comme auteur, est un romantique. La fresque qu’il a brossée avec Titanica est traversée par un "mal du siècle" résolument contemporain, mais sous ses costumes bigarrés et ses maquillages provocants, la faune qu’il met en place est éternelle.
Il a des prédécesseurs au Québec : Michel Marc Bouchard et ses Feluettes pour l’ampleur du tableau et l’élan vers l’absolu, Normand Chaurette et ses Reines pour la hauteur de ton et la quête d’immortalité. Il a également des prédécesseurs ailleurs, partout où les poètes ont voulu mesurer leurs idéaux à l’aune du réel. Mais il parle d’une voix neuve, celle de sa jeune vingtaine observant le monde exténué dont elle vient d’hériter.
Dans l’oeuvre de Sébastien Harrisson, Titanica vient avant Floes. Avant le duo, la horde ; avant le murmure, le cri. Voici, à la fois faible et forte, à la fois ridicule et sublime, une authentique parcelle d’humanité, une humanité qui rêve, qui hait, qui prie et qui arrache, une humanité qui se déguise sans pouvoir se cacher et qui même par la dérision, n’en finit pas de se briser.
Dans Titanica se côtoient deux mondes. D’une part, une société clandestine de rebelles, d’immigrants illégaux et autres poètes de l’underground hante les quais désaffectés d’un Londres secret et nocturne. Des cadavres y surgissent, des fantômes y errent depuis des siècles. Cet empire souterrain gronde de révoltes, de désirs violents, de pulsions chaotiques, de vie.
D’autre part, la royauté en personne, cette aristocratie dorée détentrice du pouvoir officiel, apparaît en quelque sorte figée dans son protocole : la monarchie britannique, soit la reine d’Angleterre et sa suite, offre une image lisse, parfaite, d’où l’on a gommé tout ce qui faisait tache.
Ces deux univers vont se fracasser l’un contre l’autre de bien des façons. D’abord, la société des ténèbres a aussi sa reine, une reine de douleur qui se promène voilée. Or, la reine de l’ombre et la reine exposée aux regards sont unies par un fil invisible ; des lettres enflammées attireront en effet la deuxième dans les zones troubles que fréquente la première.
Mais ils se heurtent aussi et surtout, ces univers, par la présence d’une oeuvre d’art qui squatte sur les quais et dont on a voulu en vain, au fil des époques faire un symbole : Titanica.
Sculpture vivante, Titanica porte depuis trente ans une robe d’acier. Comme la reine fantoche qui la convoque et qui est prisonnière de son image publique, Titanica n’est plus qu’une effigie vide de sens. À l’intérieur de la structure de métal, il n’y a plus d’individualité, plus même de corps : après sa disparition, il ne restera d’elle qu’une carcasse ouverte sur le vent.
Sébastien Harrisson aime explorer le monde des apparences, sonder les légendes éphémères de notre siècle de fugacité : il s’est intéressé ailleurs à Jackie Kennedy, à Brigitte Bardot... De ces constructions fantasmatiques, il tente de tirer l’essence, le vrai combat. Qu’est-ce qui fait courir les êtres sous leurs armures factices.
Il y a dans Titanica un enjeu fondamental : pour garder la façade intacte, on muselle la dissidence. La reine férue de botanique qui dissimule les cadavres qu’elle juge honteux dans des projets de jardins anglais résume à elle seule son époque aseptisée, une époque qui préfère taire les forces subversives qui la travaillent de l’intérieur : artistes, junkies, homosexuels, marginaux, tout ce qui transgresse la norme. Cacher les fissures, emmurer le vivant ; voilà le leurre moderne, le leurre qu’on entend ici dénoncer.
Par son nom qui rappelle l’orgueil des fragiles entreprises humaines, Titanica, était destinée à sombrer, comme sombrera ce navire éventré par le fantôme du scandaleux roi Edward. Devenue inutile dans un monde idéal – même artistique – sa "robe des grands combats" a fait d’elle une victime. Elle laisse donc à Jimmy le soin de mordre à son tour s’il trouve une cause à rallier. Mais existe-t-il encore des forces capables d’animer les rêves d’une collectivité ? "Ma vie", conclut Jimmy. Une vie : petite flamme qui vacille dans un brasier gigantesque...
Sébastien Harrisson fait intervenir dans Floes une femme enceinte depuis plus de cent ans. Dans Stanislas, texte sur lequel il travaille actuellement, il convoque la voix d’un enfant arabe enfermé dans la pierre depuis le Moyen-Âge. Dans Titanica, ce sont les spectres d’Edward II et de la reine Isabelle qui se pourchassent depuis sept siècles, et qui n’ont rien perdu dans la mort de leur passion vitale.
Depuis les confins de l’humanité, ce long "cortège de larmes", de sang, de victoires et d’échecs, les murmures de tous ces morts s’entêtent à vouloir se faire entendre, pour que l’Histoire ne les oublie pas, pour laisser une trace à la surface du monde, pour ne pas finir comme des cadavres anonymes que les millénaires empilent en douce.
Black Jack refuse de mourir en sachant que la vie continuera après lui, Titanica est terrorisée par le fait que son passage sur la terre n’aura eu aucun sens, Vivien traque les signes de l’activité de ses contemporains afin d’élaborer de monumentales "archives de l’humanité"...
Là se trouve en fait la confrontation réelle, celle qui contient toutes les autres. Leur élan vers l’infini va s’anéantir tôt ou tard, tous les personnages de Sébastien Harrisson le savent. Dans Floes comme dans Titanica, ils attendent avec douleur ce moment où, toute plainte tue, ils seront dissous dans un silence implacable qui est le nom même de l’éternité.
Diane Pavlovic, Programme du Théâtre d’Aujourd’hui, 2001
Diane Pavlovic est coordinatrice du programme d’Ecriture dramatique de l’Ecole nationale de Théâtre du Canada depuis 2001 et a été responsable de la dramaturgie au Centre d’études québécoises à Montréal, de 1994 à 2001
S’il est dans la nature des apparences de cacher les "causes profondes", il est dans la nature de la spéculation sur causes cachées d’occulter et de nous faire oublier la nudité brutale des faits, des choses comme elles sont.
Comparée à la manière sophistiquée utilisée pendant de nombreuses années pour dissimuler les faits désagréables sous le couvert d’images, voilà un surprenant retour à la plus ancienne des méthodes que l’humanité ait employée pour se débarrasser de réalités déplaisantes : l’Oubli. Ce n’est pas l’amnistie mais l’amnésie qui pansera toutes nos blessures.
La méthode consistant à ouvrir des fosses géantes pour enterrer les faits et les événements gênants fut une découverte des gouvernements totalitaires, entreprise gigantesque qui ne put être menée à bien qu’en tuant des millions de gens, acteurs ou témoins de ce passé. Le passé était en effet condamné à être oublié comme s’il n’avait jamais été. Assurément, personne ne voudrait aujourd’hui suivre un seul instant l’impitoyable logique de ces dirigeants d’hier, surtout depuis leur échec manifeste.
Dans notre cas, ce n’est pas la terreur, mais la persuasion imposée par la pression et par la manipulation de l’opinion publique qui est censée réussir là où la terreur a échoué.
Hannah Arendt, Penser l’événement, 2001
Angéla De Lorenzis : Qu’est-ce pour vous l’écriture ?
Sébastien Harrisson : Avant tout, une façon de chercher. Pas du tout une façon d’exprimer des choses que l’on saurait, mais bien plutôt la décision volontaire d’aller à la rencontre de choses que l’on ne connaît pas et dont on ne soupçonne parfois même pas l’existence. Si je sais quelque chose, je ne l’écris pas. Je n’ai pas de science à transmettre, mais je dresse des tableaux dans lesquels les gens peuvent naviguer et lire ce qui leur semble juste. C’est une façon de chercher avec les autres, en communion.
Quelle a été votre source d’inspiration pour le sujet de Titanica et pour son personnage principal ?
Je souhaitais trouver une façon de donner la parole à l’art. Pas à l’artiste, mais bien à l’oeuvre. C’est ainsi qu’est venue l’idée d’une oeuvre d’art vivante, qui serait prisonnière de sa forme, qui y serait en quelque sorte condamnée, mais qui serait lucide.
Le fait de dépeindre le jeune homme qu’a été Titanica comme un être déboussolé, sans véritable volonté, perclus de peurs, n’est pas innocent. Je ne voulais pas d’un personnage "performeur", mais bien d’un héros malgré lui, pris au jeu de l’art. Il est une oeuvre et n’a aucune prétention de créateur.
J’ai d’ailleurs volontairement tenu Edmund C. Asher à l’écart de la scène. On l’évoque mais il n’apparaît jamais. Je tenais à ce que la parole soit à l’oeuvre et non à celui qui l’a impulsée. C’est une pièce qui parle d’art, mais sans mettre en scène les artistes eux-mêmes.
Titanica ouvre un questionnement important sur l’art, son marché, la médiatisation, le théâtre, et pose la question de l’acteur : que veut dire pour un acteur "utiliser" son corps, en faire un objet de représentation, l’exposer… Pouvez-vous vous exprimer là-dessus ?
Il est difficile pour moi de parler des acteurs. Ce sont des gens que je fréquente de trop près pour pouvoir avoir une regard clair sur eux… Mais je sais que le personnage de Titanica, pour l’avoir vu interprété par différents acteurs, les inspire, leur donne matière à réfléchir à leur condition. Dans quelle mesure ? Il faudrait leur poser la question !
Toutefois, en ce qui a trait au lien entre l’art et la médiatisation, j’aurais beaucoup à dire. Notre époque est passée maître dans l’art de la récupération.
En Amérique, il est même de plus en plus fréquent d’assister à des "détournements" de sens des plus ahurissants. Par exemple, des refrains très connus, associés aux années "Peace and love" sont récupérés par des publicités de multinationales dont les visées sont aux antipodes des idéaux évoqués. On a qu’à penser à la prochaine commercialisation du modèle de basket de John Lennon par Nike avec le slogan Imagine all the people… La chose a même été autorisée par sa veuve ! Tout ce qui peut être récupéré à des fins commerciales l’est, sans égard pour le sens originel.
C’est un peu ce qui arrive à Titanica. La monarchie tente de récupérer sa charge subversive, désormais séduisante conséquemment à l’évolution des mentalités, afin de mousser un projet aux antipodes des valeurs véhiculées par l’oeuvre lors de sa création. L’idéal égalitaire incarné par Titanica se voit récupéré pour servir un projet qui a plus à voir avec la ségrégation, la discrimination. Il y là, à mon sens, quelque chose qui fait directement écho à ce qui se passe tous les jours sous nos yeux, quand on allume le couloir de métro.
"Ce n’est plus sur les champs de bataille que se mènent désormais les vrais combats" : dans quelle mesure l’art et le théâtre peuvent-ils encore être des armes ?
Bien que je fasse dire à Titanica que contre la folie du monde l’art est une petite chose vaine, je ne le pense pas pour autant. Eh oui, il m’arrive d’être en désaccord avec les idées de mes personnages, ou de ne pas y adhérer entièrement ! C’est même quelque chose d’agréable !
Je crois que l’art et le théâtre portent encore une force subversive qui peut inciter au changement, à l’évolution. Cependant, il faut être réaliste : il y a des façons mille fois plus efficaces de changer le monde que d’écrire. Je pense notamment à des gens qui consacrent leur vie à l’éducation, la santé, la défense des droits des minorités, etc. Quand on voit le travail de ces gens-là, son influence sur les populations et les sociétés, on doit admettre qu’il faut être terriblement naïf et même un brin prétentieux comme artiste pour aller s’imaginer que c’est notre petit poème qui est l’acteur du changement !
Vous mettez comme toile de fond de votre pièce les années 68 et leurs utopies. Quelles traces ont laissé ces utopies et à quel niveau d’après vous ? Votre relation avec les années 68 passe peut-être par le filtre de la génération de vos pères : quels souvenirs, quels parfums vous en restent-ils ?
Je crois que l’idéalisme de cette période, indirectement, a fait des dégâts. C’était, à mon sens, une époque de slogans, d’images fortes mais parfois dépourvues de fondement réel, plus qu’une époque de véritable réflexion. Mais quand on y pense, c’est normal, puisque c’était une époque de mouvement et d’action.
Cela explique aussi que le tout est aussi facile à récupérer, à dévier de son sens. Je sais que c’est une vision qui peut choquer la génération concernée, qui est celle de mes parents. Mais quand on y regarde de près, ils ont tout transformé en slogans, de Give peace a chance à Imagine. Alors qu’est-ce qui reste pour les générations qui suivent ? Quand on a été abreuvé de slogans, on ne fait pas de la philosophie, on fait de la publicité ! Et c’est logique…
Quelle forme d’engagement serait-il encore possible aujourd’hui ?
Je crois que l’engagement, peu importe l’époque, demeure possible. Toutefois, ce qui cause problème aujourd’hui et ce qui explique aussi qu’on se pose aussi cette foutue question par rapport à l’engagement, c’est le cynisme ambiant. L’engagement, au sens politique, même au sens amoureux, nécessite une sorte de candeur, une sorte de non méfiance qui de nos jours est plutôt rare. Mais je ne crois pas que cela rende l’engagement impossible. Seulement peut-être plus difficile, mais est-ce que s’engager est une sinécure ?
Cette pièce se construit sur un double niveau : un côté social et engagé sur les thèmes brûlants de notre actualité (l’exclusion et le sang contaminé), mais d’un autre côté le caractère fantastique (très présent dans l’ensemble de votre théâtre) fait irruption pour faire trembler l’Histoire et lui conférer un caractère onirique : c'est-à-dire que le politique et le social ne peuvent plus répondre à eux seuls à la complexité du monde ? Qu’en pensez-vous ?
Je crois que pour rendre toute la complexité de l’humanité, il faut multiplier les points de vue, les confronter, quitte à prendre le risque de finir par se contredire. Par exemple, si j’ai tenu à juxtaposer les époques dans Titanica, c’est aussi pour mettre en lumière des parallélismes inquiétants, en ce qui a trait notamment à la montée insidieuse de l’intolérance ou à l’émergence de nouvelles formes de totalitarisme.
Toutefois, il n’y avait pas l’idée de construire autour de tout ça une thèse. Non, j’avais plutôt envie de dire au public : "Regardez, ce sont deux situations qui se ressemblent étrangement… Notre réalité trouve des échos dans le passé. Où pensez-vous que ça va nous mener ?"
Comment inscrivez-vous votre démarche dans le panorama dramaturgique québécois ?
Notre tradition théâtrale est très marquée par le réalisme américain. En ce sens, mon théâtre, avec son côté plus fantastique, plus lyrique, trouve peu de parentés avec la production québécoise actuelle. Cependant, les choses tendent à bouger. Je pense notamment au travail d’Éric Charpentier, un auteur québécois qui vit maintenant en Louisiane, et qui signe des pièces que je trouve absolument fabuleuses, marquées par un univers fantastique et par une langue hybride et infiniment poétique.
Quel est le poids de l’Influence d’une culture "double", anglo-saxonne d’un côté, et française de l’autre, dans votre écriture et dans votre univers ? De quelle façon cette "mixité" inspire-t-elle, ou constitue-t-elle, le caractère spécifique de votre écriture ? En quoi (si c’est le cas) vous sentez-vous redevable à l’une et à l’autre ?
Je dirais que la "mixité" est probablement la chose la plus fertile qui soit. Le fait de parler deux langues est, notamment, une source d’inspiration incroyable. Je m’en suis d’ailleurs servi en écrivant Floes, avec cette lady anglaise qui parle un anglais hybride.
Je crois aussi que le fait de ne pas se réclamer d’une seule culture donne beaucoup de liberté. Un peu comme s’il devenait possible de s’approprier tout ce qui nous entoure, de le rêver, de le refaçonner… Vous savez, j’ai dans les veines du sang irlandais, italien, français, américain et probablement amérindien ! Avec un tel mélange, ça donne envie d’écrire sur le monde entier !
Extraits de l'entretien réalisé par Angéla De Lorenzis, août 2004
Sélection d'avis des spectateurs - Titanica
Brava Titanica Le 9 octobre 2005 à 02h23
D'excellents comédiens, une superbe mise en scène d'un texte contemporain. Ce spectacle m'a touché, intrigué, amusé aussi ! Ca fait partie de ces moments de théâtre dont il reste encore qq chose, après-coup (je l'ai vu il y a qq jours). A ne pas rater, donc !
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Brava Titanica Le 9 octobre 2005 à 02h23
D'excellents comédiens, une superbe mise en scène d'un texte contemporain. Ce spectacle m'a touché, intrigué, amusé aussi ! Ca fait partie de ces moments de théâtre dont il reste encore qq chose, après-coup (je l'ai vu il y a qq jours). A ne pas rater, donc !
Informations pratiques - Théâtre de la Commune
Théâtre de la Commune
2, rue Edouard Poisson 93304 Aubervilliers
- Métro : Mairie d'Aubervilliers à 395 m (12)
- Bus : André Karman à 77 m, Mairie d'Aubervilliers à 301 m, Paul Bert à 352 m
-
Voiture : par la Porte d'Aubervilliers ou de La Villette - puis direction Aubervilliers centre
Navette retour : le Théâtre de la Commune met à votre disposition une navette retour gratuite du mardi au samedi - dans la limite des places disponibles. Elle dessert les stations Porte de la Villette, Stalingrad, Gare de l'Est et Châtelet.
Plan d’accès - Théâtre de la Commune
2, rue Edouard Poisson 93304 Aubervilliers