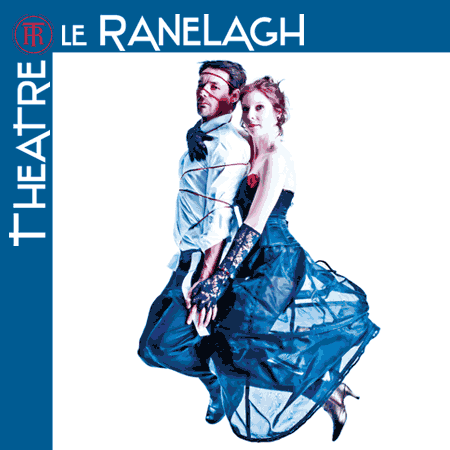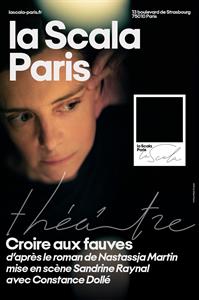Le cas de Sophie K.
Le cas de Sophie K.
- De : Jean-François Peyret, Luc Steels
- Mise en scène : Jean-François Peyret
- Avec : Olga Kokorina, Elina Löwensohn, Alexandros Markéas, Nathalie Richard, Etienne Oumedjkane
Sophie Kovalevskaïa : une rencontre
Note d’intention
Entretien avec Jean-François Peyret
Sophie Kovalevskaïa
J’ai rencontré Sophie K., comme on rencontre une femme, par hasard ; après coup le hasard se change parfois en nécessité. Ce jour-là, je baguenaudais au BHV - j’aime beaucoup le BHV ; le BHV devrait sponsoriser tous mes spectacles (ah ! le sous-sol du bricolage, quelle invitation à l’art, d’un bricolage l’autre…) -, quand passant par hasard au rayon livres du magasin, je vis, au bout de sa gondole, Sophie qui m’attendait.
Il y a souvent des gondoles dans les histoires d’amour. Le nom russe, le prénom, ce titre, Une nihiliste, sur la couverture cette femme un peu triste qui marche d’un pas décidé, vers son destin sans doute : je tombe en arrêt. Je prends le livre. Aussitôt festival de synapses sous mon crâne : elle a été admirée par Darwin, me dit la quatrième de couverture. Darwin : justement j’étais en pleine évolution ! (certains se souviennent peut-être encore des Variations Darwin ici-même). Voilà : Darwin passe le témoin, Sophie entre dans ma vie et dans mon théâtre.
Elle avait vraiment toutes les raisons d’y entrer. Sophie était même trop belle : mathématicienne et écrivain, elle met en équation la toupie et sa jeunesse en roman ; elle laisse son nom à un théorème (avec Cauchy) et signe un grand drame (avec l’écrivain suédois Charlotte Leffler), c’est donc qu’elle tente, sinon de réconcilier, du moins de concilier l’invention mathématique et l’imagination littéraire. Il y a là de quoi intriguer un théâtre qui, depuis quelques temps, se risque du côté de chez les savants. Avouez qu’il serait bien intéressant d’être dans le secret de ce cerveau amphibie ! D’où la gageure d’y installer notre scène et de tâcher de voir ce qui s’y passe, comment y coexistent la poésie ou la prose avec les équations aux dérivées partielles, le désir d’émancipation et les intégrales abéliennes dégénérées, etc.
Sophie K., c’est une oeuvre et une vie qui fut aussi un roman. Une vie brève (elle meurt à quarante et un ans en 1891) mais qui épouse son époque et s’y épuise : enfance et adolescence d’une aristocrate russe touchée par les idées nouvelles, mariage blanc pour quitter sa famille et partir faire des études, exil, l’Allemagne pour étudier les mathématiques mais sans avoir le droit de fréquenter l’université, la France de la Commune, la Suède qui lui donnera son poste de professeur l’université, le premier attribué à une femme en Europe. Et ce talent pour être aux bons endroits pour rencontrer les bonnes personnes : Dostoïevski, George Eliot, Herbert Spencer, Darwin, Tchekhov comme aussi le grand mathématicien allemand Weierstrass ou Poincaré. Une telle vie, c’est tout un monde. Les présentations sont faites : que la représentation commence.
Jean-François Peyret
Il serait tentant de dire que c’est du président de Harvard, Larry Summers, et de sa gaffe récente sur l’incapacité du cerveau féminin à faire des mathématiques, que nous est venue l’idée de consacrer un spectacle à la mathématicienne russe Sophia Kovalevskaïa. L’occasion est presque trop belle de tendre ainsi l’arc entre la Russie arriérée de la deuxième moitié du XIXe siècle, entre le combat que Sophie K. dut mener pour se faire reconnaître comme mathématicienne et une des plus performantes fabriques de cerveaux de l’Amérique d’aujourd’hui, fille aînée de la science, pour constater que le fil de l’increvable sexisme est ininterrompu. Entre les propos, tenus aujourd’hui à Harvard et ceux, par exemple, de Strindberg révolté à l’idée qu’on nomme Sophie (une femme !) à un poste de professeur à l’université, le chemin parcouru ne semble pas bien grand. Le machisme ordinaire ne serait pas seulement le fait de l’ignorant et du fruste, mais il sommeille aussi dans les esprits éclairés, à croire qu’il serait inné…
Ce serait tentant, mais malhonnête puisque notre rencontre avec S.K. s’est faite autrement, et beaucoup plus par hasard. Nous étions en effet l’an dernier en train de faire un spectacle sur Darwin lorsque Une nihiliste, le roman de notre mathématicienne parut en français ; sur la quatrième de couverture, n’était-il pas indiqué qu’elle avait épousé le traducteur russe de Darwin, qu’elle avait rencontré l’auteur de L’Origine des espèces ? Cela suffisait pour piquer notre curiosité et donner l’envie de faire entrer la mathématicienne-écrivain dans notre petit théâtre.
Que le théâtre ou le roman ou le cinéma soient tentés de s’emparer de la vie et l’œuvre de cette femme, rien d’étonnant. On dirait qu’elle épouse son époque. De son enfance d’aristocrate russe ébranlée par le nihilisme, de sa fascination pour les idées nouvelles, de son combat pour faire valoir ses droits au savoir à la victoire de son féminisme consacrée par sa chaire en Suède et la reconnaissance de son génie mathématique, en passant par la Commune de Paris, par les relations qu’elle entretint avec les plus grands esprits de son temps, elle n’a pas ménagé sa passion et on regrettera seulement qu’elle soit morte si jeune, et n’ait pas connu la suite de cette Histoire si pleine de bruits et de fureurs.
Après tout, en 1917, elle n’aurait eu que 67 ans. Ainsi ses talents mathématiques ne l’ont pas enfermée dans une tour d’ivoire ; elle était dans le siècle, et voulut s’y inscrire politiquement en luttant pour l’émancipation des femmes, mais littérairement aussi en se choisissant écrivain. Bref, pour revenir aux préoccupations de Larry Summers, le cerveau de Sophie Kovalevskaïa nous intéresse.
Il nous intéresse par son caractère amphibie, le côté scientifique et le côté littéraire, et il nous intéresse d’autant plus que notre théâtre, littéraire par vocation, cherche, depuis quelques années et quelques spectacles à être en résonance avec la science et la technique dont il est le contemporain, à s’en faire l’écho poétique, si ce n’est pas prétentieux de le dire. Qu’on me permette d’ajouter que cette démarche est, contrairement à une tradition anglo-saxonne plus riche en ce domaine, assez rare en Europe continentale. Cela signifie aussi que notre intérêt n’est pas seulement historique mais qu’il nous importait aussi d’examiner l’héritage de Sophie et de savoir ce que les scientifiques d’aujourd’hui pouvaient en faire.
Tout ce qui précède explique pourquoi nous avons fait le choix de Sophie. Il faut maintenant dire un mot du comment. Notre démarche n’est délibérément pas imitative, notre esthétique n’est pas une esthétique de la représentation ; nous ne chercherons pas à construire une fable représentative où le personnage de Sophie K. s’incarnerait dans une comédienne bien choisie. Le théâtre ici n’est pas au service de l’illusion biographique : nous avons des doutes, plus que des doutes, sur la validité (artistique ou non) de tout projet biographique, projet d’une intenable maîtrise de la part du biographe qui veut qu’une vie obéisse à un plan, qu’une vie soit de part en part intelligible. Nous ne voulons pas réintroduire sournoisement un déterminisme à qui la science à cette époque est en train de tordre le cou. Nous ne posons pas que la vie de cette femme disparue il y a 125 ans, ni que son œuvre mathématique par nature hors des prises d’un théâtre peu au fait des équations aux dérivées partielles ou des intégrales abéliennes dégénérées nous soient intelligibles et que nous pourrions rapprocher Sophie K. de nous ; non, nous chercherons plutôt à nous approcher d’elle. Ce travail théâtral est un travail d’approche par les moyens propres du théâtre (trois comédiennes et un comédien en quête de Sophie K.) prolongés par l’apport d’autres pratiques artistiques, comme ceux de la vidéo, de la musique électro-acoustique ou internet. Surtout ce spectacle sera l’occasion d’un commerce entre artistes et scientifiques dont le résultat ne sera pas une conversation académique ou mondaine mais quelque chose de fabriqué en commun : un spectacle.
Jean-François Peyret
Vous vous présentez plus comme un malade de théâtre que comme un fou de théâtre ?
Jean-Francois Peyret : Oui, je suis plutôt un incurable du théâtre qu’un fou de théâtre. Je n’avais pas de vocation théâtrale : à trois ans, je ne me disais pas je serai Brecht ou rien. Le théâtre, c’est quelque chose que j’ai “contracté” assez tard, attrapé peut-être comme une maladie. Mais c’est devenu aussi le remède. Je me guéris comme ça, pour autant que je me guérisse, de mes embarras avec la vie et mon cerveau. Une drôle de maladie, si l’on y pense, du genre : maladie de la mort ou maladie de l’amour, je confonds toujours. C’est ça qui vous tient en vie. Si je ne faisais pas de théâtre, je serais peut-être vraiment malade. En fait le théâtre me protège d’une plus grande maladie.
Dès l’origine vous vous êtes placé dans le paysage théâtral du côté du théâtre d’art, du théâtre d’essai ?
Oui comme on parlait d’un cinéma d’art et d’essai. Mais le cinéma d’art et d’essai se définissait contre un certain cinéma commercial. Mon théâtre se distinguerait bien sûr du théâtre commercial, mais tout autant de ce que j’appellerais le théâtre de culture. Essai, oui, au sens d’expérience ; j’ai toujours considéré, mais ça allait presque de soi, que l’art devait être une expérience. Il y a un théâtre conservateur d’un patrimoine en état de réanimation culturelle (et qui a toute sa légitimité, bien sûr) et un théâtre d’explorateurs, disons, de chercheurs de formes nouvelles duquel je me sens plus proche.Mais dans un autre sens, et en comparaison avec les genres littéraires, mon théâtre est aussi plus proche de l’essai que de la fiction.
Enfin, il y a un côté “tentative” dans mon théâtre, comme si on préparait un théâtre en devenir dont je ne sais pas s’il adviendra jamais. Mais je n’ai évidemment rien contre le théâtre patrimonial : il est nécessaire de monter et de remonter Hamlet par exemple, comme il est nécessaire de jouer et de rejouer les partitions musicales du passé, et de les réinterpréter. Quant à moi, j’ai, par ma formation, ma jeunesse, mon comptant de textes dits classiques. J’en ai lu pas mal dans le temps. Ma maladie, c’est la divagation (on dit ça des animaux), c’est d’aller ailleurs, même hors du champ littéraire et de défricher/déchiffrer avec le théâtre ce sur quoi je tombe. Je suis un peu hors-champ ; je fais du hors-piste. Mais je ne revendique aucune position post-dramatique ou pré-post-post-dramatique. Je sais que la psychologie des personnages n’est pas mon fort ; je cherche de nouvelles propositions à faire au public et à ceux qui dans le théâtre ont envie de me suivre.
Vous avez commencé à pratiquer un théâtre qui s’appuyait sur des textes dramatiques ou philosophiques. Aujourd’hui vous travaillez à partir de textes scientifiques ou à fortes connotations scientifiques ?
Dans les années 80, dans mon compagnonnage avec Jean Jourdheuil, notre travail était fondé sur deux choses. D’une part la poursuite de l’exploration du paysage Heiner Müller et d’autre part la théâtralisation de textes qui n’étaient pas à l’origine destinés à la scène. C’était original, puisque le premier spectacle que nous avons réalisé ensemble s’appuyait sur les Essais de Montaigne et le dernier sur La Nature des choses de Lucrèce. On prenait un texte et on voyait ce que le fait de le traiter sur un plateau permettait de saisir de lui qui n’aurait pas pu être saisi par d’autres moyens (la lecture simple, le commentaire, la thèse, l’essai).
Quand j’ai lancé, à Bobigny, le cycle des Traités des Passions, je ne travaillais plus sur un seul texte, mais sur quelque chose de noué, sur, comment dire, un problème : problème du visage, problème de l’expression des émotions… Tout cela aurait pu se traiter par d’autres moyens, essais ou romans, mais j’ai choisi de les poser et de tenter de les résoudre sur une scène en utilisant les moyens du théâtre. Donc cela concernait plusieurs textes. Par exemple : comment lire Descartes et son Traité des passions (un texte qui me passionne et qui affirme que les passions sont traitables et gérables en prenant une distance avec elles) et en même temps mon dramaturge préféré, Racine (qui affirme que les passions sont intraitables) ?
Donc il fallait inventer une forme dans laquelle les deux positions arrivaient à coexister. En fait, je passais d’une pensée dialectique de la contradiction à une pensée de la différence… Ensuite je me suis promené du côté de la science, de l’imagination scientifique, à la suite de rencontres avec des biologistes qui étaient venus voir des épisodes du Traité des passions. Cela a alimenté chez moi une réflexion sur le vivant, sur le partage vivant-artificiel, donc sur des problématiques explicitement contemporaines : les questions de la technique, de la techno-science, des bio-technologies, etc. C’est ainsi que j’ai pu faire trois spectacles avec Alain Prochiantz et que je retrouve, pour Avignon, Luc Steels, spécialiste de l’intelligence artificielle que j’avais rencontré et attiré dans notre théâtre au moment de nos spectacles consacrés à Alan Turing. Pour moi, le théâtre est aussi un moyen de poursuivre une conversation entre amis qui doit devenir proposition de théâtre faite à d’autres amis qui sont les spectateurs.
Ensuite vous avez abordé Le Traité des formes…
En fait cette formulation était une formulation/formation de compromis. Alain Prochiantz, en tant que neuro biologiste spécialiste du développement, s’intéresse aux formes du vivant ; j’avais envie, de mon côté, en tant que faiseur de théâtre, d’utiliser polémiquement l’idée de forme, contre celle de sens, de message, et autres calamités. De fait, notre travail d’écriture du spectacle est essentiellement de nature formelle : tâcher de faire émerger une forme, à inventer à partir des différents matériaux sans savoir au commencement ce qu’elle sera, sinon qu’elle devra être une expérience pour la sensibilité du spectateur. Je propose des choses à la sensibilité des acteurs d’abord puis à celle des spectateurs sans me préoccuper de “vouloir dire”. Sans surtout vouloir émettre des opinions. L’opinion est l’opium du peuple.
Vous dites que chacun de vos spectacles est déjà “gros” du suivant…
Oui, car dans mon travail je ne passe pas d’un auteur à l’autre avec l’éclectisme du metteur en scène. J’essaye que mes petites spéculations s’enchaînent et je me fie aussi au hasard : pour Sophie Kovalevskaïa, je suis tombé par hasard sur son roman traduit l’an passé : Une nihiliste. J’ai découvert qu’elle était la femme du naturaliste russe Kovalevski, le traducteur en russe de Darwin sur lequel je travaillais pour le spectacle Les Variations Darwin. Cela a suffit.
Sophie Kovaleskaïa est une personnalité d’une richesse incroyable : mathématicienne, romancière, engagée dans la Commune de Paris… Quelle facette voulez-vous privilégier dans votre travail ?
Ma méthode de travail avec les comédiens ne me permet pas encore de vous répondre, car je ne le saurai qu’à la fin de l’expérience, si je le sais. Actuellement, nous constituons un corpus de documents, de matériaux, de textes, destinés aux comédiens. Puis ce sera le travail sur le plateau qui déterminera la forme. Donc comme on peut entrer dans un mort comme dans un moulin, pour l’instant avec Luc Steels, nous avons pratiqué plusieurs entrées dans notre héroïne : enfance, Commune de Paris, rencontre avec Dostoïevski, théorème mathématique, nihilisme, théorie du chaos, Poincaré, etc. Tout cela sera confronté à la machine théâtrale et les acteurs vont partir en balade dans ce moulin…
Est-ce que ce sera comme un voyage dans le cerveau de Sophie Kovalevskaïa ?
Oui… on a même des photos de son cerveau qui, à sa mort, a été recueilli, analysé, photographié. Ce cerveau de femme, de mathématicienne, de féministe, qui a réussi à avoir la première chaire de mathématique à l’université de Stockholm dans les années 1880 (en France il faudra attendre 1938 pour qu’une femme obtienne une chaire universitaire en mathématique), le prix Bordin en 1888, morte à 41 ans, est un cerveau passionnant à étudier, surtout au moment où le recteur de l’université de Harvard lance une polémique sur l’inégalité des performances intellectuelles entre hommes et femmes…
Comment constituez-vous le texte théâtral que vous donnez aux comédiens au début des répétitions ?
C’est ce que j’appelle “la partition O” qui regroupe des textes d’origines différentes : certains ne sont que des informations (de la dramaturgie, si l’on veut), d’autres sont davantage destinés au jeu. Quand ils improvisent, ils doivent respecter à la lettre ce qui est écrit sans jamais broder. C’est la seule règle de ce jeu. Au terme de notre travail, un texte existe, a été écrit, est joué tous les soirs, mais qui est en quelque sorte sans signature, dégriffé.
Votre théâtre est donc extrêmement dépendant du travail des acteurs ?
En vérité, l’objet de ma curiosité, ce qui m’intrigue encore au théâtre, ce sont les comédiens. Leur personnalité bien sûr, mais aussi le simple fait qu’il y ait du comédien dans la société… Ces bêtes curieuses. J’aime aussi beaucoup mélanger des personnalités qui ne se seraient peut-être pas rencontrées sans mes propositions. J’ai une vraie jubilation à les voir se promener dans des endroits bizarres pour eux, comme en pays étrangers. Les protéines infectieuses, ce n’est pas obligatoirement le quotidien de l’apprentissage d’un jeune comédien du TNS, du Conservatoire ou d’ailleurs… Ce mouvement de déplacement, de “déterritorialisation”, je le trouve productif du point de vue de l’imaginaire. Je lance les comédiens dans ces matériaux et, par un retournement de situation, ce sont eux qui ensuite me guident, me dirigent. Je suis attentif à leur voyage qui nourrit le mien. Il y a du coup de dés là-dedans. On lance les comédiens et on voit ce qui en sort.
L’art du metteur en scène consiste seulement à tricher un peu avec le sort, à changer le hasard en nécessité. Je ne fais jamais de très longues lectures à la table, elles pourraient d’ailleurs durer des heures, puisque le théâtre que je fais n’existe que parce qu’il faut bien aller occuper le plateau vide. Le texte ne peut prendre force que lorsqu’il passe par le corps, lorsqu’il brûle les corps. Il y a donc de longues improvisations filmées, parfois jusqu’à épuisement des acteurs, et ensuite un choix est fait, le plus souvent douloureusement, car il faut éliminer des moments très forts. C’est là qu’est “l’essai” dont je parlais précédemment : on ouvre la “partition O” n’importe où, les comédiens s’emparent du texte et le musicien propose un environnement sonore. C’est un travail de confection à partir des imaginations de chacun : moi je suis le régisseur qui ordonne, qui fixe cette matière très riche, souvent au vol. Il ne faut pas dormir.
Vous dites que le théâtre est aussi un moyen de lutter contre le multimédia envahissant ?
Lutter, lutter ! Je ne sais pas, et je ne me pare pas des plumes du résistant. Mais je suis très respectueux du dispositif acteur/spectateur tel que nous l’avons hérité des Grecs, au fond. Il n’y a pas besoin de faire participer artificiellement le spectateur en lui demandant d’appuyer sur un bouton pour savoir si Marie-Antoinette doit mourir ou non… Si j’invite Luc Steels à travailler avec moi sur l’intelligence artificielle, je le fais en tant qu’homme de théâtre et pour faire du théâtre.
L’idée que le spectateur est trop passif au théâtre et que, disons, le multimédia va l’activer un peu, est stupide. Un spectateur qui écoute, comme un lecteur qui lit, n’est pas passif, il se passe énormément de choses dans son cerveau. Il faut se méfier du spectateur qui dort : son cerveau peut être en état d’alerte maximale, plus que s’il était devant une console vidéo. Si j’ai recours aux nouvelles technologies, ce n’est pas pour céder au goût du jour mais tout autant pour les analyser, les critiquer. Car je ne trouve pas que ce soit forcément une très bonne nouvelle que cette part de plus en plus grande du mécanique, du technique dans notre vie. Mais nous vivons dedans, dans cette relation homme-machine, dans la reproductibilité à l’infini, et il est important de convoquer ces questions au théâtre. Il ne s’agit pas seulement d’utiliser les nouvelles technologies ; il faut aussi les interroger. Le théâtre en est-il capable ?
Votre théâtre apparaît souvent comme le lieu de la pensée, mais n’est-il pas aussi celui de la jouissance ?
Oui, mais cela n’est pas contradictoire, et en vieux brechtien que je suis, je pense que la pensée est un des plaisirs de l’humanité. Alors, jouissance est peut-être un grand mot. Je parlerais plus modestement de jubilation. Je n’aimerais pas faire un théâtre chagrin. Mon horizon : la jubilation tragique.
Propos recueillis par Jean-François Perrier, pour le dossier de presse du Festival d’Avignon 2005
Nabokov déplorait avec raison l’ignorance en laquelle les Occidentaux ont toujours tenu les réalités du monde russe, et particulièrement l’état de la société éclairée dans la Russie de la fin du XIXe siècle. A cette époque, à Moscou et Saint-Pétersbourg comme au fin fond des campagnes, une large frange de l’aristocratie et de la bourgeoisie, acquise aux idées nouvelles et en inventant au besoin, penchait pour la révolution : peu de ces gens étaient d’accord sur la forme à donner à ladite révolution, mais développer en son salon des thèses socialistes, féministes, communistes, anarchistes (on préférait alors dire « nihiliste » – un terme popularisé par Tourgueniev) était presque devenu la règle… tandis que les partisans de l’autocratie tsariste, s’ils tenaient fermement le pouvoir, se gardaient de plus en plus de prendre la parole. C’est cette société-là qui, après avoir raté son coup en 1905, finira par triompher en février 1917, pour se voir confisquer sa révolution dès octobre, à l’issue du coup d’État fomenté par la minorité léniniste… confiscation qui allait entraîner pour près d’un siècle la régression politique, sociale, intellectuelle et morale que l’on sait.
Sophie Kovalevskaïa, comme une large part de sa famille, comme aussi des milliers de femmes russes de son temps et de son milieu, appartient à cette remuante intelligentsia. La famille en question ressemblait à beaucoup d’autres : des propriétaires terriens de la région de Vitebsk, un papa noble et militaire (il avait commandé l’arsenal de Moscou)… et une bibliothèque où se bousculaient les ouvrages de tous les penseurs sulfureux de l’époque. A 13 ans, Sophie dévore les journaux, s’intéresse aux mathématiques et déplore de ne pouvoir se rendre à Varsovie faire le coup de feu au côté des insurgés contre les troupes du tsar. L’année d’après, « montée » à Saint-Pétersbourg avec sa sœur Anna qui se pique d’écrire, elle est remarquée par Dostoïevski qui tombe aussitôt amoureux des deux jolies provinciales et se fait éconduire : trop bourgeois.
Les deux sœurs, entourées pourtant d’admirateurs, ont résolu de mener une existence de leur façon : adeptes de l’union libre, féministes endiablées, elles feront l’une et l’autre des mariages « politiques » (unions non destinées, au départ, à être consommées) avec des « mari-frères » eux-mêmes dévoués à la Cause… Chacune de ces dames menant ensuite, parfois loin de l’époux élu, une existence d’une totale liberté. Et le papa général, après avoir regimbé un instant, finit par céder tout ému, fait bénir tout ce petit monde par le pope, et envoie régulièrement des roubles aux deux couples qui voyagent, allant d’université en université. Parfois l’affaire se met à sentir le roussi : Anna et Sophie sont sur les barricades de la Commune de Paris aux côtés de Louise Michel, et leur brave général de père doit intervenir en personne auprès de l’intraitable M. Thiers pour sauver la peau de son aînée et de son gendre, condamnés à mort comme insurgés.
Une vie mouvementée qui n’empêche pas ces dames de se cultiver. Sophie étudie les mathématiques à Berlin, passe un doctorat à Göttingen en 1874 (elle sera la première femme docteur en mathématiques de la planète), séduit Darwin et George Eliot, tandis que son « mari », le complaisant Vladimir Kovalevski, docteur à Iéna, fonde l’école russe de paléontologie. Où va donc s’arrêter la belle Sophie, qui de ville en ville fait chavirer tous les cœurs ?
Elle a 25 ans quand l’université de Stockholm lui offre une chaire de mathématiques (la première au monde qu’une femme ait jamais occupée), ce qui lui vaut les foudres de Strindberg, antiféministe à tous crins. Quatre ans plus tard, l’Académie des sciences de Paris lui décerne un prix pour ses recherches sur la rotation des solides, puis l’Académie des sciences de Russie (les autorités tsaristes ferment les yeux sur ses « idées ») lui ouvre sa porte – elle a 29 ans.
Est-elle heureuse ? Oui et non. Son « mari » et elle ont fini par faire un enfant (une petite Sophie qui deviendra elle aussi une mathématicienne), mais lui considère qu’il a raté sa vie avec elle (il se suicide en 1883), et la voici de nouveau seule, tombant amoureuse mais faisant bientôt fuir ses amants qui la trouvent trop « libre » (elle les recrute pourtant dans la fine fleur des intellectuels en révolte). Elle se tourne alors vers l’écriture, compose un drame, puis Une nihiliste, roman qui ne paraîtra qu’après sa mort (une pleurésie mal soignée), sera traduit en plusieurs langues, puis interdit dans plusieurs pays, puis « redécouvert » récemment aux Etats-Unis (2001).
Notes biographiques, Editions Phébus
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Chaillot - Théâtre national de la Danse
Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris
- Métro : Trocadéro à 96 m (6/9)
- Bus : Trocadéro à 31 m, Varsovie à 273 m, Pont d'Iéna à 301 m
Plan d’accès - Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris