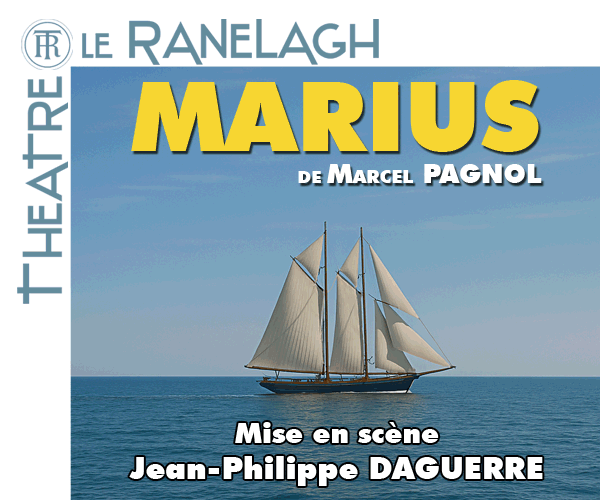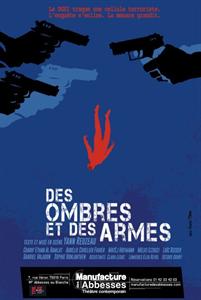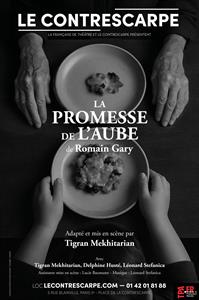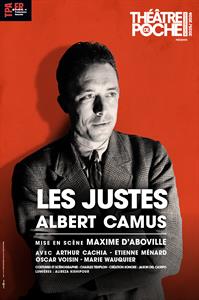La Danse de mort
La Danse de mort
- De : August Strindberg
- Mise en scène : Jacques Lassalle
La Danse de mort est l'histoire d'une vérification par la souffrance, d'une rédemption accordée à «ceux qui vivent en enfer».
Pendant qu'il écrivait La Danse de mort, Strindberg consacrait à la question du couple un texte révélateur, qu'il devait publier quelque temps plus tard en 1902 sous le titre :
Le Deuxième récit du maître de quarantaine.
En voici un extrait : «La question est de savoir si, par suite de la vie en commun, les mauvaises pensées de l'un n'arrivent pas à être perçues par l'autre, avant même d'être achevées, et si elles ne se présentent pas à lui comme déjà parvenues au stade de la conscience et cherchant délibérément à se réaliser. Il n'y a rien de plus blessant que de voir quelqu'un lire au fond de vous et seuls deux époux en sont capables. Ils n'arrivent pas à cacher ce qu'il y a de ténébreux au fond de leur âme et ils pressentent les intentions de l'un quant à l'autre, ce qui leur donne aisément l'impression de s'espionner et c'est effectivement ce qu'ils font. Ne craignant rien tant que le regard de l'époux ou de l'épouse, ils se trouvent désarmés l'un en face de l'autre. Ils ont un juge à leurs côtés, qui condamne dans l'oeuf même toute mauvaise envie qui germe, alors que selon la loi de la société, on ne peut être tenu pour responsable de ses pensées».
Si cette remarque est vraie pour un jeune couple qui s'aime encore, elle l'est d'autant plus pour un vieux couple qui, au cours de longues années de vie commune, a eu l'occasion de tout inventorier. Et cela ne vaut-il pas également pour l'observateur trop perspicace d'autrui ?
Avant de recevoir son titre définitif, la pièce a porté dans l'esprit de Strindberg plusieurs titres différents, comme en témoignent ses premières ébauches : « Tout revient », « La lutte avec la mort », « Danse macabre » et « Préparatifs à la mort ». Ces titres ont cependant en commun de parler tous de mort, et on peut se demander si ce n'est pas là le véritable sujet de la pièce et s'il n'a pas été abusivement éclipsé par la présence et l'horrible vitalité du couple infernal du capitaine et d'Alice.
La véritable origine de la pièce ne serait plus alors le séjour de Strindberg auprès du couple orageux que formaient sa sœur Anne et son beau-frère Hugo dans leur maison de Furusund en juin 1899, mais cette fameuse nuit du 18 au 19 janvier 1900 où Hugo fut victime d'une hémorragie cérébrale. En vérité, La Danse de mort est l'histoire d'une vérification par la souffrance, d'une rédemption accordée à «ceux qui vivent en enfer». C'est avec ce chef-d'oeuvre que Strindberg a été définitivement reconnu, d'abord en Allemagne, puis partout dans le monde, comme l'un des tout premiers artisans de génie du passage du naturalisme à l'expressionnisme.
D'après Carl-Gustav Bjurströn
Traduction et adaptation Terje Sinding
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 7 rue Boudreau 75009 Paris
- Métro : Opéra à 162 m (3/7/8), Havre-Caumartin à 189 m (3/9), Madeleine à 298 m (8/12/14), Saint-Lazare à 398 m (3/12/13/14)
- RER : Auber à 40 m (A), Haussmann Saint-Lazare à 314 m (E)
- Bus : Auber à 24 m, Opéra à 107 m, Havre - Haussmann à 148 m, Gare Saint-Lazare - Havre à 301 m, Madeleine à 359 m, Pasquier - Anjou à 367 m
Plan d’accès - Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Square de l'Opéra-Louis Jouvet, 7 rue Boudreau 75009 Paris