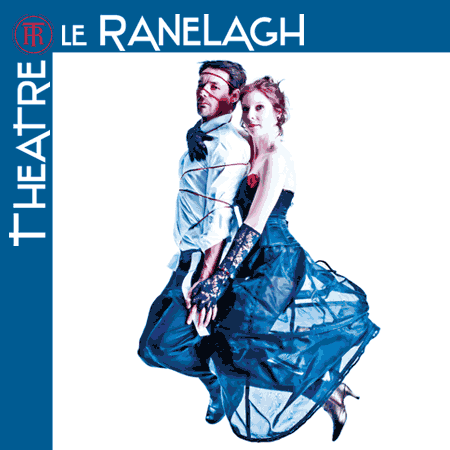Brand
Brand
La passion de Brand
Brand versus Peer Gynt
De la donation du sens
La genèse de Brand
Peur de la lumière
Tout ou rien : l’aspiration de Brand à une vie juste ne saurait souffrir aucune limitation. Ce désir d’absolu moral se heurte de plein fouet aux contradictions et aux compromis dont s’accommodent les autres, emportant dans une tornade de sacrifices mère, femme et enfant. Destructrice ou rédemptrice, la passion de Brand traverse comme une question brûlante le monde bourgeois médiocre contre lequel s’élève l’œuvre d’Ibsen.
Brand a été écrit en 1865. Le texte français d’Eloi Recoing est publié chez Actes Sud-Papiers.
« Brand », nom qu’on rencontre fréquemment en Scandinavie comme en Allemagne, signifie en norvégien « incendie » ou « brandon ». L’auteur l’a choisi non seulement pour symboliser la ferveur de son héros, mais encore pour indiquer sa propre intention, qui est de « mettre le feu aux âmes… »
Extrait de la préface au texte français de Brand établi
par le comte Prozor,
Librairie académique Perrin & Cie, Paris, 1903
En 1867, alors en exil en Italie, Ibsen compose un extraordinaire « poème dramatique » intitulé Peer Gynt. Cette œuvre, qu’Ibsen n’écrit pourtant pas pour la scène, va avoir une fortune scénique considérable, et nombreux sont les metteurs en scène qui, depuis 1876, date de la première représentation en Norvège, s’attèlent à cette pièce-fleuve avec ses dizaines de personnages et de décors, et qui défie les lois du théâtre comme on défie celles de la pesanteur.
C’est en travaillant à mon tour, en 1996, à une mise en scène intégrale de Peer Gynt (avec déjà Claude Duparfait et Philippe Girard à qui j’avais respectivement confié la jeunesse et l’âge mûr du rôle), que je découvris qu’Ibsen avait, deux années avant Peer Gynt, composé un autre « poème dramatique » : Brand. Les deux pièces sont très souvent associées par les spécialistes, mais à la différence de Peer Gynt, Brand est rarement portée à la scène - en France, la pièce fut créée par Lugné-Poe en 1895 et, à ma connaissance, seulement remontée par Georges Pitoëff pour le centenaire de la naissance d’Ibsen en 1928, puis, dans une adaptation, par Gilles Bouillon, en 1977.
Force est de constater pourtant que les deux pièces se répondent : par leur démesure, leurs paysages, leurs questionnements, et bien évidemment par leurs figures centrales qui semblent dessinées comme l’inverse l’une de l’autre. Brand, c’est l’anti-Peer. Et à la fantaisie théâtrale qui s’accorde à la personnalité fantasque du second s’oppose le théâtre austère et néanmoins spectaculaire que vient recouvrir de toute son ombre la silhouette protestante du premier.
Les fjords de Peer sont enchantés par ses mensonges et ses rêves de chevauchées à dos de renne, ceux de Brand sombres comme des ciels d’orage repeints par son Dieu de colère (on pense aux films de Dreyer…). Peer s’obstine toute sa vie à « ne rien commettre d’irréversible », il rechigne à toute forme d’engagement et dépense son incroyable vitalité à fuir tout ce qui de près ou de loin peut ressembler à la mort. Brand s’acharne à ne rien concéder de son engagement, « tout ou rien » est sa devise. Peer est une sorte de caméléon protéiforme capable de s’adapter à toutes les situations, jusqu’à se perdre et ne plus savoir qui il est. Brand, tout d’un bloc, s’acharne à tout plier à sa devise et à sa vocation de réconcilier coûte que coûte la vie et la foi.
Mais, à sa façon, lui aussi fuit la mort ou la dénie. En exigeant de tous d’être à l’image de Dieu, et en s’infligeant, à lui et à ses proches plus qu’à tout autre, cette exigence, il semble qu’il cherche à échapper aux vanités terrestres et aux douleurs humaines, et que l’obsession du salut des âmes immortelles serve aussi de diversion à l’angoisse d’être mortel. Ainsi Brand et Gynt, les deux opposés, se retrouvent peut-être dans la même angoisse et les mêmes tremblements (pour parodier Kierkegaard auquel on rapproche souvent le personnage de Brand), dans leur mégalomanie et dans leur folie.
Après avoir travaillé l’an passé sur Les Revenants, dont l’un des personnages est aussi un pasteur, mais un pasteur compromis, je me suis aperçu que Brand portait non seulement Peer Gynt en gestation, mais aussi toute l’œuvre à venir d’Ibsen. Les grands paysages y font déjà place au théâtre de l’intime qui sera celui de sa maturité, et les scènes « familiales » dans le petit presbytère au pied du fjeld annoncent sans aucun doute Les Revenants ou Petit Eyolf. Quant au dernier acte, c’est déjà à la fois Un ennemi du peuple avec ses scènes de confrontation de l’individu avec la foule et Quand nous nous réveillerons d’entre les morts avec ses avalanches…
Dans une période où les extrémismes politiques et religieux font un retour inquiétant, je me suis dit que la radicalité d’un Brand (après celle d’Alceste) méritait d’être interrogée, en n’oubliant pas qu’elle traduit aussi la virulence d’Ibsen l’exilé contre la Norvège de son temps. Avec Brand, il ne s’agit plus seulement comme pour le « misanthrope » de Molière de faire la critique des discours complaisants ou hypocrites et de s’indigner à tout va jusqu’à se retirer dans un « désert », il s’agit d’accorder sans répit les actes aux discours, avec une intransigeance fanatique et de plus en plus désespérée : son désert sera celui d’une « Église de glace »…
Stéphane Braunschweig
Un poème dramatique, incendiaire et catastrophique : telle m’est apparue, en première lecture, cette oeuvre d’Ibsen. La forme en est stricte et sévère. Une métrique implacable. Vers iambiques ou trochaïques donnent à l’ensemble un caractère tendu, dense et dru, hirsute et plein d’aspérités. Féroce dans la pensée, extrême dans la douleur, inspirée mais jamais verbeuse, la parole de Brand, l’apôtre de sa propre folie - celle du « tout ou rien » - est à certains égards pudique et retenue. Comme si le feu intérieur débordait sur les lèvres en un torrent de glace. Je devais, à tout le moins comme traducteur, écrire à mon tour un poème dramatique.
Le comte Prozor en son temps fit le choix de traduire en prose. Certes, il donne à entendre clairement la fable mais renonce à nous donner la moindre idée du style, c’est à dire du rythme, par quoi le sens véritablement se délivre. Il s’inscrit dans une logique d’effacement de l’origine étrangère de l’oeuvre. Celle-ci finit par s’apparenter au théâtre d’Émile Augier ou à quelque chose d’approchant. La Chesnais, quant à lui, tenta de relever le défi de la versification. Sacrifiant le sens pour d’improbables octosyllabes, il aboutit à un texte abscons et proprement injouable. Instruit par ces deux tentatives, j’ai opté pour un vers libre. Oui, j’ai voulu conserver l’idée du vers, ce blanc qui sépare et scande, tout en maintenant l’unité de sens dans l’unité de vers. J’ai préservé de cette façon le mouvement rhétorique de la pensée, les effets d’enjambements, les mots pivots qui font retour, le réseau des signifiants, le travail de l’inconscient. Bref, j’ai voulu rendre compte de la forme sans pour autant m’enfermer dans l’horizon historique d’une métrique ayant fait date mais désormais datée. La destination scénique du poème a commandé mes choix prosodiques.
La question du souffle est cruciale au théâtre. Il ne fallait rien sacrifier du sens dans une oeuvre profondément philosophique. Mais il fallait absolument donner l’idée du rythme par quoi le verbe se fait chair sur la scène.
Si Brand peut, comme son nom l’indique, enflammer les esprits, il le doit à son verbe. En remettant mes pas dans les pas du poète, en épousant la forme de son absence, j’accède à son délire, j’éprouve les mouvements contradictoires qui le travaillent, je replonge dans le vieux fond biblique aussi bien que dans la tragédie antique. Je reconnais au passage les lambeaux de vieilles sagas nordiques, mais aussi les éclats philosophiques de ses contemporains. Je vois le poème comme une chimère qu’anime la colère du poète, fondue à la forge de son souffle et c’est cela tout d’abord que j’ai voulu traduire.
Toute traduction véritable est une métamorphose de l’original. Mais pour autant, cet acte poétique, dans la torsion opérée, cherche à ne pas détruire la structure initiale. Au contraire, il en répond. Telle fut du moins mon ambition. Que le rythme soit la donation du sens.
Éloi Recoing
« En Italie, je trouvai l’unité accomplie grâce à une ardeur de sacrifice illimitée, au lieu que dans mon pays ! Joins à cela l’idéale paix de Rome, la fréquentation d’insouciants artistes, une existence qui ne se peut comparer qu’au charme d’As you like it de Shakespeare, et tu connaîtras la genèse de Brand. C’est une erreur absolue de croire que j’aie voulu peindre la vie de Sören Kierkegaard. (J’ai peu lu Kierkegaard et je l’ai encore moins compris). Que Brand soit prêtre est un fait sans importance. Le « tout ou rien » s’applique à la vie entière, à l’amour, à l’art, etc. Brand, c’est moi dans mes meilleurs moments ; de même que l’analyse personnelle a fourni bien des traits du personnage de Peer Gynt (…).
Quand j’écrivais Brand, j’avais sur mon bureau un scorpion dans un verre. De temps en temps l’animal tombait malade ; je lui donnais alors un fruit sur lequel il se jetait avec rage pour y verser son venin ; après quoi il redevenait bien portant. N’en va-t-il pas de même de nous autres, poètes ? Les lois de l’organisme s’étendent au domaine intellectuel. »
Extrait d’une lettre d’Ibsen à P. Hansen du 28 octobre 1879
Du temps que j’allais à l’école,
je ne manquais pas de courage, -
c’est-à-dire, jusqu’au moment où le soleil
se couchait derrière le sommet de la montagne.
Mais quand les ombres de la nuit
couvraient la croupe des monts et les tourbières,
j’étais effrayé par les hideux fantômes
des fables et des contes.
Et pour peu que je fermasse les yeux,
je faisais des rêves en foule, -
et tout mon courage était envoyé -
Dieu sait jusqu’où !
Maintenant il s’est opéré un changement
complet en mon esprit ;
maintenant mon courage s’en va quand je marche
À la clarté du soleil levant.
Maintenant ce sont les gnomes du jour,
maintenant c’est le vacarme de la vie,
qui répandent dans mon sein
toutes les terreurs glacées.
Alors je brave la mer et les flammes ;
Je fends la nue comme le faucon,
J’oublie angoisse et misère
Jusqu’à l’aube suivante.
Mais quand l’abri protecteur de la nuit
me fait défaut,
Je ne me sens capable de rien ; –
Oui, si jamais je fais quelque chose de grand,
Ce sera une oeuvre de ténèbres.
Henrik Ibsen
La Peur de la lumière, Ressouvenances, 1985, pp.11-13
Trad. C. De Bigault de Casanove
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - La Colline (Théâtre National)
La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris
- Métro : Gambetta à 73 m (3/3B)
- Bus : Gambetta - Pyrénées à 53 m, Gambetta à 56 m, Gambetta - Mairie du 20e à 141 m
-
Station de taxis : Gambetta
Stations vélib : Gambetta-Père Lachaise n°20024 ou Mairie du 20e n°20106 ou Sorbier-Gasnier
Guy n°20010
Plan d’accès - La Colline (Théâtre National)
15, rue Malte Brun 75020 Paris