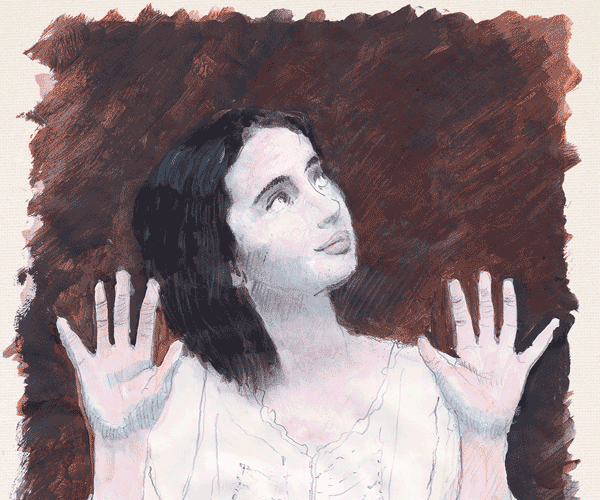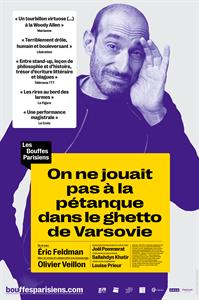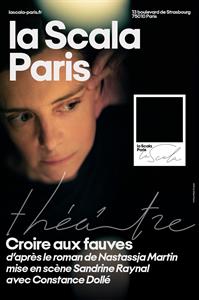Oh les beaux jours - (Happy Days)
Oh les beaux jours - (Happy Days)
- De : Samuel Beckett
- Mise en scène : Deborah Warner
- Avec : Fiona Shaw, Tim Potter
Spectacle en anglais surtitré en français.
« Hé oui, si peu à dire, si peu à faire, et la crainte si forte, certains jours, de se trouver… à bout, des heures devant soi, avant que ça sonne, pour le sommeil, et plus rien à dire, plus rien à faire, que les jours passent, certains jours passent, sans retour, ça sonne, pour le sommeil, et rien ou presque rien de dit, rien ou presque rien de fait. (Elle lève l’ombrelle.) Voilà le danger. (Elle revient de face.) Dont il faut se garer. »
Winnie, héroïne de la pièce Happy Days (Oh les beaux jours) écrite directement en anglais en 1961 par Samuel Beckett (il en fera une version en français en 1963 pour Madeleine Renaud), est enfoncée jusqu’au torse dans un mamelon terreux au centre d’une étendue d’herbe brûlée qui semble devoir l’absorber peu à peu tout entière.
Tandis qu’impitoyable le soleil darde ses rayons, Winnie s’abrite de son ombrelle, bavarde, chantonne, fouille dans son sac à main, embrasse le canon d’un revolver, évoque ses souvenirs, ses petits malheurs, se tait, prie, s’absente, s’adresse à son Willie de mari, lequel répond quand ça lui chante, préférant lire un journal défraîchi ou scruter une carte postale pornographique… Habitée par le jeu puissant de Fiona Shaw, Winnie rayonne, goûtant jusqu’au bout ce que la vie lui accorde.
Ses mots, d’autant plus précieux qu’ils sont entrecoupés de silences, témoignent d’un humour féroce mais revigorant qui font de cette pièce, aussi paradoxal que cela puisse paraître, une leçon de vie.
Au cours de leur aventure féconde, Deborah Warner et Fiona Shaw avaient déjà abordé, il y a plus de dix ans, l’univers de Beckett en montant Footfalls (en français Pas), spectacle qui n’avait malheureusement pu être joué sur les scènes françaises. Aussi est-ce une chance de découvrir enfin comment Deborah Warner et Fiona Shaw appréhendent la sensibilité à l’œuvre dans le théâtre de Samuel Beckett avec cette mise en scène créée et accueillie avec succès en janvier au National Theatre de Londres.
Hugues Le Tanneur
- Dans les sables de Beckett
J’ai toujours entretenu un rapport difficile avec Samuel Beckett. Quand j'étais plus jeune, il représentait pour moi cette affectation dépressive tellement en vogue parmi les étudiants en licence : "Essaie encore, échoue encore, échoue mieux", tout ç a... Pourtant, séduite par le très beau rôle, j’ai joué Footfalls (Pas) à la fac, dans l'esprit le plus beckettien du monde, devant un seul spectateur plus un vigile qui était entré là parce qu'il pleuvait dehors.
Puis, il y a plus de dix ans, j’ai joué Footfalls à Londres dans une mise en scène de Deborah Warner que nous devions ensuite présenter à Paris. Cela ne se fit jamais. L'épisode est connu : le spectacle fut interrompu par les ayants droit après quelques représentations. Beckett n'était mort que depuis cinq ans et j'imagine que toute adaptation dans la pièce, aussi mineure soit-elle, était un sujet encore beaucoup trop délicat. Je me souviens du co-producteur français déclarant avec un certain panache : "Une absence est parfois plus forte qu'une présence." Un point de vue particulièrement désintéressé quand on considère qu'ils venaient de perdre 25 000 livres.
Et donc, quand cette production de Happy Days (Oh les beaux jours) s’est présentée, de nouveau mise en scène par Deborah Warner, j'admets avoir été sur mes gardes. Dans les indications scéniques de Beckett, le personnage de Winnie a "la cinquantaine", et moi qui ai quarante-huit ans, je me sens beaucoup plus jeune. Mais comme l'a remarqué Susan Sontag, "se décrire comme jeune, c’est admettre qu’on ne l’est plus." J’ai donc décidé de considérer l'indication d'âge comme une sorte de mode d'emploi, et je suis allée chercher non pas du côté du cliché de la femme au foyer des années cinquante (Happy Days a été publié en 1960) mais parmi les femmes d’aujourd’hui que je connais.
Les répétitions commencèrent en décembre et je trouvai mon texte difficile à apprendre. Les images ne se bâtissaient pas dans mon esprit, au contraire elles s'y décomposaient : la langue de Beckett n'est que pensée interrompue. Comme s’il avait écrit sur le revers, ses idées ne se dévoilant que par radiographie. Je jugeais cela pas très généreux, voire cruel de sa part. Une comédienne rêve de rôles qui embrassentune destinée universelle, pas les aléas de sa féminité. J’avais là un personnage qui semblait manquer de mots pour mériter sa présence sur scène.
Quand les répétitions se faisaient laborieuses et monotones et que je n'en pouvais plus de rester assise dans les sacs de sable empilés autour de moi, on s'arrêtait pour jouer au badminton. Parfois Happy Days n’était plus du tout une pièce de théâtre pour moi, mais une installation qui parle, tantôt du point de vue du personnage, tantôt par la voix de l'inconscient. Ce vers de The Wasteland (La Terre vaine) de T.S. Eliot ne cessait de me revenir en mémoire : "Je veux de ces fragments étayer mes ruines". Comme ils étaient riches, ces fragments, à côté des demi-répliques livrées à Winnie pour qu'elle bâtisse son monde intérieur !
Et puis, après quelques semaines de répétitions, une lumière est apparue dans la pénombre. Le réalisateur Roger Michell, qui avait été l’assistant de Beckett en 1979 sur Happy Days au Royal Court avec Billie Whitelaw dans le rôle de Winnie, vint nous rendre visite. Il ouvrit son texte et nous lut ses notes prises à l’époque, griffonnées dans les marges d'une toute petite écriture serrée (Beckett faisait la même chose sur son exemplaire). Il nous parla de la gentillesse de l’auteur, de son humour, de son humilité, et même du magnétisme qui se dégageait de sa personne. Nous nous sommes épanchées, lui disant toute notre perplexité, nos idées confuses. Roger Michell reconnut alors les difficultés de l'œuvre, et puis il dit : "Mais au bout du compte tout le monde aime Winnie, parce que Winnie, c'est la vie." Je me suis accrochée à ça, bien des fois, au cours de ces dernières semaines.
Mes marques pour le rôle, je les ai alors trouvées dans la vie, autour de moi. Enfant, une femme que je connaissais avait un mari qui ne lui répondait plus depuis des années. Je me souviens, elle lui disait : "Ça te va, le repas, mon chéri ?" Et puis elle continuait à causer, comme s’il lui avait répondu : "C'est bon." Elle se cramponnait à son mariage, au bord du précipice, exactement comme Winnie. Quelque chose, quoi que ce soit, c'est toujours mieux que rien.
Beckett sait l’immense distance qui sépare la solitude de l'isolement, et c'est ce qui fait de lui plus un peintre qu’un auteur dramatique. En tant que comédienne, j’ai fini par me demander si nos métiers – ceux d’auteur et d’interprète — n'étaient pas fondamentalement opposés. Les comédiens ont besoin d'inventer des liens entre des corps apparemment étrangers, alors que c’est la distance entre les choses, entre les gens, qui fait toute la résonance de l’écriture de Beckett. Il a besoin du froid comme moi j’ai besoin de la chaleur.
Edward Albee affirmait que Beckett était un naturaliste. Cela m’avait d'abord semblé saugrenu mais me paraissait de plus en plus crédible. Après tout, Winnie et Willie sont un couple, ils trouvent probablement leurs origines dans la banlieue d'une grande ville, quelque part. Beckett les a simplement transposés dans le vide et dans l'intemporel pour s'affranchir de tout pittoresque domestique.
A l’approche de la première, je dormais de moins en moins. Une simplicité monacale ordonnait mes journées : ni désordre, ni radio, ni journaux. Mais nous gardions notre sens de l’humour. Le matin du premier filage, je venais de commencer à jouer quand j’ai distingué la tête de Deborah Warner, effondrée. On est parties sur un fou-rire. Elle disait : "Je suis témoin d'une non-révélation."
Quand les indications scéniques sont aussi abondantes que chez Beckett, on peut penser qu’elles vont éclaircir le texte. Il n'en est rien. Il y a cent cinquante "temps" dans Oh les beaux jours, et aucun n’a la moindre signification si on ne l'habite pas, avec de l’imagination, de la tension ou de la pensée. C’est ce qui rend les répétitions si difficiles. La précision technique ne vous fait pas gagner la bataille, elle ne vous mène qu'à la moitié du chemin.
Mais j’avais enfin commencé à entendre ce texte. On ne peut pas savoir Oh les beaux jours par morceaux. Oh les beaux jours ne fonctionne qu'en entier. Ce n’est pas un texte narratif, et pourtant on y trouve des variations de sentiments magnifiquement modulées.
Au cours de la dernière semaine de répétitions, je fus prise par mon angoisse habituelle. Tous les soirs je me couchais avec le livre de James Knowlson sur Beckett, en en lisant des courts passages. Je n’ai jamais été de ceux qui explicitent les œuvres par la biographie de leur auteur, mais j’étais ravie de découvrir que la prière que Beckett disait dans son enfance finissait comme celle de la pièce, et que lui aussi se souvenait de quand il était dans le ventre de sa mère, comme le personnage de Mildred. J'y voyais alors des choses vraies et intimes plutôt que des constructions intellectuelles.
Il ne nous restait que quelques jours quand Deborah et moi déjeunâmes avec Edward Beckett, le neveu de Samuel, un rendez-vous attendu depuis fort longtemps. Il ressemble tellement à son oncle que j’eus l’impression de rencontrer l'auteur. Il fut charmant et nous raconta les dîners hebdomadaires avec Beckett à Paris quand il y était étudiant.
Notre dernier filage fut un peu brutal. Toutes les pièces que j’ai jouées dans cette salle du National Theatre, le Lyttleton, me revenaient en mémoire. J’y ai toujours la même loge depuis plus de vingt ans.
Jeudi dernier, c’était notre première avant-première. Nous avons démarré le spectacle en découvrant la présence saisissante d’un public, éclairé par la lumière aveuglante qui déborde du plateau. Au bout de quelques secondes, ils riaient, et l’alchimie de la rythmique beckettienne, cet espace entre le vide et l'humour, était libérée.
C’est toujours le public qui vous apprend le véritable sens d'une pièce. Là où, tout au long des semaines précédentes, je percevais de la froideur, je sens maintenant l’énergie du jeu télescoper ce minimalisme de l’écriture. La pièce alors est ressentie comme un pic de chaleur et de lumière : humaine, emportée, étrangement festive. Après le spectacle, on me transmet un petit mot de Deborah : "Eh ben dis donc. Alors c’est ça, la pièce ?"
Demain nous échouerons encore. Espérons que nous échouerons mieux.
Par Fiona Shaw. Ce texte a paru dans TheGuardian du 23 janvier 2007, à la veille de la première de Happy Days au National Theatre. Traduit par Harold Manning
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Chaillot - Théâtre national de la Danse
Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris
- Métro : Trocadéro à 96 m (6/9)
- Bus : Trocadéro à 31 m, Varsovie à 273 m, Pont d'Iéna à 301 m
Plan d’accès - Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris