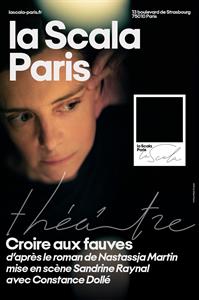Kliniken
Kliniken
- De : Lars Norén
- Mise en scène : Jean-Louis Martinelli
- Avec : Brigitte Boucher, Eric Caruso, Zakariya Gouram, Sylvie Milhaud, Charles Bénichou, Séverine Chavrier, Emmanuel Faventines, Vincent Macaigne, Abbès Zahmani, Marie Matheron, Sylvie Milhaud, Sophie Rodrigues, Sabrina Kouroughli
La maladie de la société
Entretien avec Jean-Louis Martinelli
Espace commun d'une clinique psychiatrique, lieu de rassemblement pour les hommes qui ont été exclus par l'économie sociale et apparemment ne sont pas pressés d'y retourner. Parmi eux, Martin qui a réussi dans la pub avant d'apprendre qu'il était séropositif. Sa femme et ses enfants l'ont quitté et il s'est effondré. Maud, une secrétaire de 52 ans souffre de dépression nerveuse chronique, cela empire tous les 2 ans. Markus, schizophrène est là depuis toujours. Mohammed attend la réponse à sa demande d'asile, sa famille a été massacrée par ses voisins serbes. Roger, skinhead, a tendance à insulter sauvagement et à agresser les autres. Sofia, anorexique, 18 ans, se sent déjà très vieille. Un animateur affirme être leur infirmier, mais finalement qu'importe, la différence est le fruit du hasard. Les 13 personnages de Kliniken vivent dans leur bulle et tournent autour de leur propre nombril.
Dans cette pièce documentaire, Lars Norén fait le constat de la maladie de la société et atteste de la santé flamboyante de ceux que l'Etat a déclaré fous. Eux, en effet, poursuivent "à l'intérieur" ce qui est valable à l'extérieur : la théorie néodarwiniste et néolibérale de la loi du plus fort. Là, dans cet espace psychiatrique, la communauté suit ses intérêts égoïstes et les lois hiérarchiques. Là, frustrations et agressions se déchargent sur les plus faibles et l'on meurt de manière terrible et angoissante.
Kliniken a reçu en 1998 le Nordic Drama Award, remis tous les deux ans à un auteur scandinave pour l'une de ses pièces. Ce spectacle sera l'occasion d'un nouveau rendez-vous de Jean-Louis Martinelli avec Lars Norén : après avoir monté Catégorie 3.1 en 2000 et accueilli deux mises en scène de l'auteur suédois aux Amandiers (Måsen/La Mouette en 2002, Guerre en 2003), il aborde Kliniken, l'une des 14 pièces dites "pièces mortes" (De döda pjäserna), 14 pièces écrites de 1989 à 1995 où Norén explore le monde capitaliste de la fin du XXème siècle et l'image collective que nous avons de nous-mêmes, particulièrement celle résultant de circonstances extérieures comme l'effondrement de l'Etat providence.
"Comme souvent dans les manuscrits du dramaturge suédois le plus estimé depuis August Strindberg, certaines répliques restent dans vos pensées pendant des jours, peut-être même des années après les avoir entendues pour la première fois." Gunnar Rehlin
"Dans la pièce Kliniken, les patients et l'environnement de l'hôpital psychiatrique donnent une image effrayante de notre temps. Lars Norén montre aussi un nouveau pathos socio-politique. Il nous dévoile les gens au fond de notre société et comment nous sommes tous dans une "maison" qui commence à s'écrouler. C'est une effrayante, terrible et brillante pièce d'aujourd'hui." Jury du Nordic Drama Award
Texte français d'Arnau Roig-Mora, Jean-Louis Martinelli et Camilla Bouchet. Le texte Kliniken est publié aux éditions de l’Arche.
« C’est la maladie du corps social qui est sur scène. »
En 2000, vous créez au Théâtre National de Strasbourg Catégorie 3.1 de Lars Norén. Depuis cet auteur a croisé votre chemin plusieurs fois, de différentes manières : accueil de sa mise en scène de La Mouette en 2002 aux Amandiers, création de Guerre mise en scène par Norén en français en 2003, etc. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec lui et avec son écriture ?
En 1998, j’ai présenté à Stockholm une pièce d’Heiner Müller Germania 3. À ce moment-là, le conseiller artistique du théâtre Dramaten m’a dit que je devrais rencontrer Lars Norén et lire sa dernière pièce Personkrets. J’ai donc rencontré Norén une première fois, la discussion était sympathique mais un peu tendue, nous rapprochions nos univers littéraires et théâtraux, à bâtons rompus, comme cela. J’ai ensuite fait traduire une quinzaine de pages de Catégorie 3.1 et j’ai décidé de le monter, sans avoir lu la totalité de la pièce.
Il y a une vingtaine d’années - au moment où était présenté à l’Odéon, je crois que c’était La Force de tuer - j’avais lu tout le cycle des premières pièces de Norén, ce cycle où il parle de la famille bourgeoise suédoise, de la névrose familiale, des mères absentes, qui communiquent avec leurs enfants par téléphone, du rapport à l’inceste, etc. Quelque chose me frappait déjà dans cette écriture : le sentiment que cela procède par accumulation. Je trouve que Norén écrit des pièces qui nous transportent entre le point de départ et la fin de la pièce avec des moyens relativement simples. L’air de rien. Et que cela procède par accumulations successives, par couches, et il nous donne la résolution, en fait pas forcément la résolution, puisqu’il n’y a jamais de résolution, mais plutôt l’épaisseur du conflit interne et interpersonnel. Ceci par petites touches successives. Je ne l’ai jamais questionné sur son rapport aux impressionnistes mais cela m’intéresserait de savoir comment il parle de cette peinture. J’ai l’impression que cela fonctionne pareil. Comme si le tableau se dessinait petit à petit, on ne prendrait qu’un fragment, on ne verrait rien, mais si on s’éloigne, c’est-à-dire quand on a lu toute la pièce, on peut alors entrer à l’intérieur. Ceci était déjà très sensible dans ses premières pièces.
Ensuite, en travaillant sur Catégorie 3.1, j’ai retrouvé toute cette richesse-là avec, en plus, une dimension que je qualifierais de post-bergmanienne. En effet, le premier cycle de pièces pourrait être classé dans une catégorie « Bergman » ou « Strindberg » - on peut faire un amalgame assez rapide. Et là, tout à coup, c’est comme s’il y avait l’irruption du XXe siècle, en même temps que l’éclatement de la famille bourgeoise suédoise et même de la société suédoise, peut-être les deux à la fois. C’est sans doute lui qui sort de l’appartement suédois, qui sort de la famille, qui sort de l’obsession d’une certaine façon. Qui semble sortir de l’obsession. On a donc Catégorie 3.1, Kliniken, 7.3, un cycle de trois pièces auquel on peut ajouter Froid, et même ses dernières pièces, même si elles sont un peu ailleurs.
Toutefois, je dis qu’on n’est pas sorti totalement de sa première période d’écriture parce que même s’il pousse encore plus loin la notion d’éclatement, s’il y a encore moins d’histoire, on est toujours dans le conversationnel mais fragmenté et fragmentaire. Et en même temps, tout ce qu’on a vu se développer comme thèmes majeurs dans les pièces de la famille se retrouve à nouveau par bouts, par bribes, à l’intérieur des personnages. Les femmes parlent de leurs fils, les pères montrent les photos des enfants dont ils n’ont plus la garde, les enfants jouent au foot, etc. On retrouve aussi le rapport à la maladie mentale, qui traverse toujours tout, et pas seulement Kliniken, mais toutes les pièces. C’est comme si les murs de ces maisons dont il a parlé pendant vingt ans s’étaient brisés ou volatilisés et qu’il remettait ces personnages-là dans des espaces publics, dans des espaces collectifs, la place, la prison, l’hôpital. Mais ce sont les mêmes êtres. C’est une collection de ces personnages avec tout ce qu’ils traînaient et qui se résolvait seulement au moment du repas de famille, dans le huis clos de l’appartement bourgeois suédois qui se retrouvent dans des espaces publics.
Ce n’est peut-être pas par hasard que le conseiller artistique du Dramaten m’a parlé de Norén et de Catégorie 3.1, parce que Germania 3 d’Heiner Müller est une pièce qui procède aussi complètement par fragments. C’était un spectacle très éclaté. Dans Kliniken, on a, comme Norén le dit lui-même, des bouts mis bout à bout et à la fin, cela devient une pièce. On est dans le discontinu, dans le fragment avec ces pièces-là. Du coup, ça pose toujours un défi au théâtre, quelle histoire va-t-on raconter ? Si on me demande de résumer Catégorie 3.1, je n’y arrive pas. En tout cas pas de façon linéaire et narrative. Il n’y a pas de fable à strictement parler. C’est comme si Norén prenait une photo d’une douzaine de personnes, et à la fin du spectacle, on a l’impression qu’on connaît chacune d’entre elles. Et ça c’est formidable ! On les connaît non pas par les grands récits qui auraient traversé toute la pièce - même s’il y en a quelques-uns - mais par le biais des conversations dont on a été les témoins, avec l’un ou avec l’autre.
Quand j’avais lu les premières pages de Catégorie 3.1, j’avais beaucoup ri. Alors est-ce les pièces de la première période de Norén qui sont dures ? Ou est-ce un tempérament trop sérieux et trop rationaliste du théâtre français ? Mais à l’instar de Müller - parce que je pense qu’il y a un peu la même méprise, même chez Thomas Bernhard d’ailleurs - ce sont pour moi de grands ironistes. Et il suffit de voir le regard de Norén, de le voir deux, trois fois et on a tout compris. Il a une vraie dimension d’humour et de provocation. J’ai donc beaucoup ri aux douze première pages, et je crois que c’est aussi une façon de se défaire et de se déprendre de parvenir à mettre en jeu cette ironie de l’histoire, même si elle s’appuie sur des êtres blessés, entravés, malmenés. Si on arrive à cela, je pense qu’on se préserve ainsi d’un effet misérabiliste, compassionnel. J’ai vraiment très envie de cela. Certes, on ne peut pas le monter si on n’est pas vraiment dans un geste de compassion, mais en même temps on est là pour montrer des processus.
L’autre danger à éviter sur des pièces comme Catégorie 3.1 ou Kliniken, c’est comment ne pas faire spectacle de la misère du monde. Il y a deux travers possibles : celui-là, c’est-à-dire comment les grands couturiers par exemple s’emparent de costumes de clochards, font des défilés de mode et vendent cela très cher, ça c’est de l’indécence et de la pornographie pure, mais le théâtre peut faire pareil, et se nourrir des poubelles du monde. Ça c’est le premier travers et le deuxième étant de pleurer sur cet état du monde. Comment être simplement les témoins de ces processus d’exclusion et de mise à la marge ? Et comment l’acteur se tient à sa juste place, pas dans un effet de vérisme et de recomposition. Il s’agit de retrouver la langue, les rapports, d’en parler et probablement d’alléger un peu le réel, sans aller vers le numéro de clown, vers la parodie, mais de lui donner un peu d’oxygène quand même.
Vous évoquez beaucoup Catégorie 3.1…
Bien sûr, il y a un lien entre les deux pièces. On est dans deux espaces de huis clos ouverts, qui sont la place publique et la salle commune. Deux espaces d’enfermement, même la place publique car ils ne savent pas aller ailleurs. Ils sont condamnés à errer sur place. Et de même à l’hôpital, les personnages pourraient en sortir mais ne le font pas. Pour moi, ces deux pièces sont très proches dans la construction. Dans Catégorie 3.1, on n’est pas dans un hôpital psychiatrique, mais ils sont tous atteints des mêmes maux, qui de la drogue, qui du SIDA, etc. C’est vraiment un diptyque.
Monter Kliniken vous permet donc de poursuivre ce travail commencé avec Catégorie 3.1 ?
Ce travail avec Norén je l’ai continué après Catégorie 3.1, puisque quand j’étais à Strasbourg j’ai passé commande de la traduction de sa pièce Embrasser les ombres à Louis-Charles Sirjacq, dont on a fait une lecture pour France Culture avec Sylvie Milhaud, Thomas Blanchard, Alain Fromager et André Wilms, pièce qui a été ensuite montée à la Comédie-Française, mise en scène par Joël Jouanneau. En même temps, on ne se pose pas vraiment la question de continuer, on refait autre chose, je ne sais pas ce qu’on va fabriquer avec Kliniken mais en tout cas, cette pièce appartient à la même famille, celle qui m’intéresse le plus chez Norén.
Et comment placeriez-vous l’écriture de Norén dans le paysage théâtral ?
Le danger quand on monte un auteur ou qu’on écrit une biographie, c’est de dire c’est le plus grand auteur du siècle ! Je ne lis pas assez de théâtre, j’en lis beaucoup mais je n’ai pas la prétention de connaître suffisamment le répertoire du théâtre européen. Ce que je peux dire c’est que parmi ce que je connais et les auteurs que j’ai montés, c’est pour moi une rencontre aussi forte que celle que j’ai eue avec Müller, Céline, Pasolini. Je le mets à cet endroit là. C’est quelqu’un qui donne de grands coups de pied au cul dans la marche du monde, avec une économie de moyens qui génère une poétique très surprenante. Je crois que ce n’est pas par hasard s’il a appelé une de ses pièces Détails. Pièce dans laquelle il s’intéresse aux premiers signes de séduction, de rapports amoureux et aux premiers signes de dérapages et de fin des histoires. Je pense qu’il y a beaucoup de choses chez lui qui jouent sur les détails, même dans ses grandes fresques. Ça ne se situe pas dans la généralité. D’abord parce que chaque personnage est singulier, mais aussi parce qu’il s’attache à des petites choses, quand je parlais d’impressionnisme tout à l’heure… Oui, cela avance comme cela.
Avez-vous déjà travaillé sur la folie, la maladie mentale ?
Un des premiers textes que j’ai monté en 1978 était Lenz, la nouvelle de Büchner, qui est un magnifique essai sur la schizophrénie. Il était question que je travaille avec des malades dans un hôpital de Lyon et je n’ai pas voulu y aller, parce que je ne me sentais pas équipé, parce que je ne suis pas thérapeute. Même si je dirais qu’à des moments on peut, face au travail lui-même, face aux acteurs, face à l’autre simplement, se retrouver dans la position du thérapeute qui porte un diagnostic, mis à part que moi je n’ai pas à m’intéresser au traitement ! Je vais simplement m’intéresser à ce que l’acteur produit. C’est là qu’on pourrait dire qu’il y a quelque chose de proche. La semaine dernière, j’ai travaillé avec des gens du CASH de Nanterre. Après, on peut s’interroger et savoir s’il n’y a pas de vertu justement thérapeutique induite par le fait de ne pas se poser comme thérapeute. J’ai travaillé avec eux comme avec des acteurs. En mettant une pression forte sur ce qu’il fallait produire et faire. On a vu des choses sortir qu’on n’avait jamais vues. Avec des gens qui soi-disant ne parlent pas et qui, en quatre jours, sortent un texte d’une demi-page. Et le disent debout, face aux autres. Bien sûr, dans la durée, je pense que le processus ne tiendrait pas.
Ce qui me frappe dans Kliniken, c’est qu’il n’y a pas de personnel soignant. Cela me fait penser à ce que dit Jean Oury , le psychiatre de La Borde, à savoir qu’une partie du traitement se fait de malade à malade. Et c’est ce qu’on voit dans la pièce, ça parle beaucoup, les réponses sont parfois dures mais il n’y a pas de jugement et c’est cela que je trouve formidable, il n’y a pas d’instance de jugement. Les choses sortent. On est presque face à une analyse de groupe. Et en même temps, au bout du compte, il y a une forme de respect qui circule entre tous ces êtres.
Y a-t-il des limites à représenter la folie sur un plateau ?
Il n’y a aucune limite. Simplement on est là pour organiser des signes, je ne suis pas là pour créer un miroir du réel, je suis là pour produire des signes qui renvoient au réel. Si j’organisais le réel, je prendrais des malades, avec leurs propres textes et voilà, on fait de la télé-réalité ou du théâtre-réalité. Alors, comment rendre compte de la folie ? On peut le faire par une exagération du réel, mais ça ne m’intéresse pas. Justement tout à l’heure j’ai parlé d’un travail par touches, comment arriver à cela ? Je pense qu’à ce niveau-là, les rapports, les situations, la langue nous aident.
Il en irait de la représentation de la folie comme de la représentation de la violence. Si j’ai à représenter un viol sur scène ou quelqu’un qui en égorge un autre... Si un acteur arrive avec une tronçonneuse sur scène et coupe la tête d’un autre : d’abord, cela ne sert à rien car personne ne va le croire, et le lendemain dans les journaux, on lira : Oui ! Il lui a bien coupé la tête ! Bref, ça ne produit rien. C’est beaucoup plus intéressant de montrer quelque chose qui est de l’ordre du pulsionnel, de l’inconscient. De plus, dans Kliniken, on n’est pas face à des cas cliniques sévères. Ni face à de la parole incohérente. Il y a seulement Markus qui est dans l’incohérence totale, les autres sont plutôt dans la fracture. Peu ou prou, 80% des gens présents dans la salle pourraient monter sur scène, se mettre petit à petit à parler et on s’apercevrait qu’on n’est pas si loin… Et c’est ce qui m’intéresse, qu’on soit là, à la limite de la maladie.
Au début du travail sur les costumes avec Patrick Dutertre, par exemple, on voulait rendre compte de l’hôpital psychiatrique. Et puis on s’est dit qu’on se trompait. Parce qu’on allait désigner un autre. Du coup, on va prendre des fripes. On va traiter les costumes sans souci d’harmonie. Alors que l’espace recrée quelque chose qui est une forme de cohérence, les costumes vont jouer le disparate pour renvoyer à ce côté échantillon de population. Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment les questions économiques, comment la non-inscription sociale et la surdétermination de l’enfance créent du trouble psychologique fort, qui relève de la psychiatrie.
Un des personnages, Erika, dit « c’est seulement la classe ouvrière qui vient ici ». La maladie mentale est-elle aussi une question de classe sociale ?
Ce qui me semble évident et qui le sera encore plus dans les années à venir, c’est qu’il y a une inégalité terrible d’accès à la santé entre celui qui possède et celui qui ne possède pas. Comment aller chercher du travail avec des dents pourries quand ce n’est quasiment pas remboursé ? Il en est de même pour ces maladies-là. L’ensemble de l’accès à la santé est à double vitesse et va l’être de plus en plus. Parce que d’abord on ne sait pas, on prend sur soi, ou alors c’est de la sur-médication ou bien de l’automédication. Sous prétexte de parler de la santé mentale, cette pièce parle de la santé d’un groupe social et même d’une société. C’est la maladie du corps social qui est sur scène. Les acteurs sont comme douze pathologies, douze manifestations et on va étudier ces signes-là, qui révèlent l’état du reste du monde.
Kliniken a été écrit à Stockholm en 1994, vous le mettez en scène à Nanterre en 2006, n’y a-t-il pas des décalages ?
Je vais répondre à l’envers : Aziz Chouaki écrit Une virée qui se déroule à Alger en 1992, moi je le crée à Nanterre en 2004, puis Norén me dit il faut le faire à Stockholm et on le monte là-bas en 2005. Ça fait forcément écho, tous ces symptômes-là. Je crois qu’à la mondialisation correspond des maux qui se répandent de la même façon que les multinationales et que les capitaux qui traversent le monde. Les problèmes de société s’universalisent. Et ils sont plus accrus d’ailleurs dans les pays les plus pauvres puisque les écarts sont encore plus frappants. Je n’ai jamais senti autant ce qu’était la société libérale qu’au Burkina-Faso par exemple. Parce qu’il y a dans la même image une publicité de Coca-Cola et dessous un enfant meurt de faim. C’est cette violence-là. De même les enfants, qui n’ont pas de quoi manger, viennent au centre culturel français de Bobo-Dioulasso regarder toute la journée des séries américaines. Et ils voient toute la richesse du monde qui s’étale. Après on s’étonne que ce soit violent, ça pourrait l’être beaucoup plus.
Nathalie Mercier et Amélie Wendling, 24 novembre 2006
Kliniken – Bande-annonce
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Nanterre - Amandiers
Nanterre - Amandiers
7, av. Pablo Picasso 92000 Nanterre
- RER : Nanterre Préfecture à 773 m (A)
- Bus : Théâtre des Amandiers à 7 m, Joliot Curie - Courbevoie à 77 m, Joliot-Curie - Courbevoie à 133 m, Liberté à 171 m, Balzac - Zola à 278 m
-
Voiture : Accès par la RN 13, place de la Boule, puis itinéraire fléché.
Accès par la A 86, direction La Défense, sortie Nanterre Centre, puis itinéraire fléché.
Depuis Paris Porte Maillot, prendre l'avenue Charles-de-Gaulle jusqu'au pont de Neuilly, après le pont, prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre, suivre Nanterre Centre, puis itinéraire fléché.
Plan d’accès - Nanterre - Amandiers
7, av. Pablo Picasso 92000 Nanterre