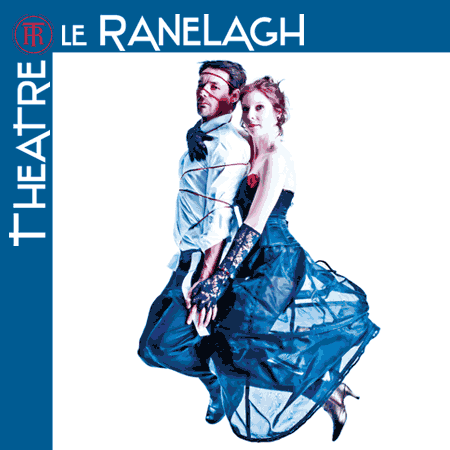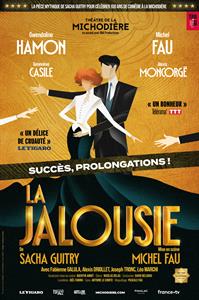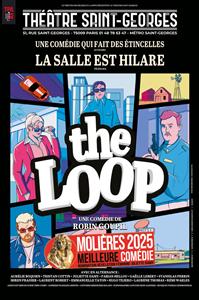Une famille aimante mérite de faire un vrai repas
Une famille aimante mérite de faire un vrai repas
Coup de cœur de la rédaction Le 23 mai 2016
- De : Julie Aminthe
- Mise en scène : Thibault Rossigneux
- Avec : Elizabeth Mazev, Philippe Girard, Pauline Dau, Anthony Roullier
Une famille aimante mérite de faire un vrai repas - Photographies
Une famille ordinaire, vivant aujourd’hui en France. Une mère ultrapossessive, un père hygiéniste, une fille hyperlucide, un fils geek à tendance autiste. Chez les Lemorand tout va bien et pourtant tout grince. Leur normalité met en évidence leurs névroses quotidiennes, reflet d’une société malade où la famille n’est plus un rempart mais le microcosme où tout se déconstruit.
- Humour cruel
« Quel bonheur de se plonger dans l’humour cruel de Julie Aminthe !
Le titre m’a tout de suite intrigué. Dernier d’une “tribu” de 8 enfants, j’ai immédiatement été interpellé par :
- la référence à la “famille aimante”, pilier fondateur, mais aussi rouleau compresseur
- la notion de mérite, mère des névroses de notre délicieuse société judéo-chrétienne et surtout l’invitation au “vrai repas”, plongée dans une enfance blanquette de veau d’une famille traditionnelle de la banlieue ouest mais autoproclamée moderne.
Dès les premières pages j’ai ri, comme ça ne m’était pas arrivé depuis longtemps, mais en même temps une gêne m’a sournoisement envahi. Pas seulement liée aux regards surpris de mes voisins de terrasse pris en otage par mes réactions étouffées, mais surtout par le drame quotidien et inéluctable qui se jouait devant mes yeux. Cette comédie redoutable me permet de porter au plateau, avec jubilation, les sujets les plus graves qui m’accompagnent de façon plus ou moins assumée dans mes différentes propositions. Cette pièce miroir questionne la fin des illusions, la perte de repères, l’énigmatique référence au genre, l’échec de la transmission. Ce huis clos familial est criant d’une vérité impudique aux retentissements universels. Les quatre personnages cohabitent dans ce format explosif que peut être la famille. Leurs obsessions névrotiques sont drôles et touchantes car vraisemblables.
J’aime aussi l’idée de poursuivre mon questionnement, entamé avec ma précédente mise en scène Corps Etrangers de Stéphanie Marchais, sur l’étouffante référence à la norme. Je trouve très juste l’interrogation de chacun vis à vis de son positionnement dans le clan familial, comme si les rôles étaient prédéfinis et qu’il leur fallait s’ajuster à ces costumes étriqués. Le père se doit d’être protecteur mais il fuit cette responsabilité accablante dans le mensonge et dans une quête hygiéniste. La mère est là pour AIMER. Elle est d’une maladresse touchante et destructrice qui montre qu’elle n’est pas non plus à sa place. Les parents, tout en les surexposant à leur mal-être, maintiennent leurs deux ados dans un statut post-enfantin alors qu’ils sont armés d’une hyperconscience explosive.
C’est dans des situations ultra-quotidiennes, définies dans des scènes à deux habilement rythmées que la comédie vire progressivement et imperceptiblement au drame. Les masques tombent. C’est ce virage qu’accompagnent le jeu des acteurs, la scénographie, les costumes, les lumières et les sons.
Tout démarre avec les codes d’un théâtre bourgeois, quasi boulevardier pour se muer en drame social fantasmagorique. Ce texte est une machine à jouer pour les quatre acteurs dont les partitions sont très équilibrées et merveilleusement évolutives. Pour faire partager le dérapage de cette famille ordinaire, il faut tisser immédiatement les rapports entre chaque personnage. Des petits gestes simples et quotidiens doivent trahir la parole immédiate et installer le trouble. L’humour nait de l’absolue justesse des relations entre mari et femme, père et fille, père et fils, mère et fils, mère et fille, frère et soeur, sans oublier que ces duos s’inscrivent dans une histoire collective soucieuse des normes sociétales. La folie vient du progressif décalage qui bouleverse des situations apparemment normales.
Une tournette hypnotique de 7m de diamètre scande les séquences et codifie l’espace. Tout le reste du plateau est une sorte de coulisses à vue où les interprètes sont les témoins impuissants du drame qui les submerge. Avec ses vêtements, la fille crée, à la manière des prisonniers en évasion, des cordes lui permettant d’échapper au cocon familial. Nous exploitons ainsi la verticalité en utilisant les talents de cordiste de Pauline Dau qui s’installe un nid protecteur en canopée. Cette scénographie, aux motifs géométriques obsessionnels, se déconstruit progressivement à l’instar des repères de notre société.
La normalité des costumes nous rassure et nous donne le code de cette famille aimante où chacun est à sa place. Mais progressivement des détails de l’accoutrement de chacun traduisent le dérapage : impudeur de plus en plus marquée de la mère, juxtaposition d’accessoires « ménagers » greffés sur la tenue de bureau du père, virage guerrier du fils et accumulation d’habits par la fille qui prépare sa fuite.
La lumière défini dans la première partie des espaces cloisonnés. Progressivement elle se répand de manière virale à l’ensemble du plateau ne permettant à aucun des personnages d’échapper au piège qui se tisse. Latéraux et noirs favorisent un jeu d’apparitions et disparitions qui rythment cette intrigue en short cuts. Des tableaux muets, chorégraphiés et pratiquement subliminaux s’immiscent progressivement dans notre récit et créent le trouble.
De même le travail sur le son nous fait basculer d’un univers quotidien, léger, à un déraillement sournois de ce foyer en implosion. Ca grince, les sons se déforment, sont imperceptibles ou trop forts... La partition propose une fin ouverte, qui laisse libre cours aux projections fantasmées de chacun. Tout s’écroule dans une succession de tableaux violents qui s’enchainent rapidement jusqu’au noir. »
Thibault Rossigneux
Une famille aimante mérite de faire un vrai repas – Bandes-annonces
Sélection d'avis des spectateurs - Une famille aimante mérite de faire un vrai repas
Un spectacle d’une qualité artistique remarquable Par Spectatif - 21 mai 2016 à 12h39
Mais c’est du délire que ce spectacle ! Et quand je dis délire, croyez-moi, ça en est : j’y étais, j’ai tout vu !... Un joyeux délire jusqu’au boutiste fleurant bon le grand n’importe quoi, jonglant avec le tout est possible et souriant avec des petites perles musicales, posées ici et là, servant de pauses bienvenues et charmantes dans la marche inéluctable de ce chantier nihiliste. Une pièce pleine de surprises et de plaisirs. L’auteure Julie Aminthe publie cette pièce en 2014. Elle rejoint ce torrent qui déferle sur notre théâtre contemporain, parmi les Jean-Michel Ribes, Evelyne de la Chenelière, Pierre Notte, Jean-Marie Piemme ou Pierre Guillois, par exemple. Torrent d’où giclent et courent ces propositions folles et trash qui remuent la vie comme on remue la terre pour faire voir et entendre les quatre vérités de notre réalité. Sortes de miroirs savants qui nous aident à réfléchir par le média du rire. Dans cette pièce, les préparatifs d’un repas de fête obligeant une famille à rester groupée, permet à l’auteure d’en disséquer tous les possibles. Des névroses de chacun aux difficultés de la parentalité, en passant par les mensonges, les espérances et les crises qui fondent une famille ordinaire… Tout est bon pour montrer l’improbable par l’imaginaire. Ça implose, ça explose, ça expose et ça part dans tous les sens ! On sourit et on rit (il y en a même qui crie !) de s’être laisser prendre et surprendre par ce pataquès énorme. La mise en scène de Thibault Rossigneux joue des effets avec efficacité et habileté, le tout au cordeau. Les comédiens Pauline Dau, Philippe Girard, Elisabeth Mazev et Antony Roulier font du beau travail. Ils dépotent, ils assurent, ils impressionnent. Ils sont vraiment bons. Une peinture trash des détours et des contours de nos manies et de nos fantasmes (enfin, surtout des autres !). Un spectacle d’une qualité artistique remarquable. Incontournable !
Moyenne des avis du public - Une famille aimante mérite de faire un vrai repas
Pour 1 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Un spectacle d’une qualité artistique remarquable Par Spectatif (104 avis) - 21 mai 2016 à 12h39
Mais c’est du délire que ce spectacle ! Et quand je dis délire, croyez-moi, ça en est : j’y étais, j’ai tout vu !... Un joyeux délire jusqu’au boutiste fleurant bon le grand n’importe quoi, jonglant avec le tout est possible et souriant avec des petites perles musicales, posées ici et là, servant de pauses bienvenues et charmantes dans la marche inéluctable de ce chantier nihiliste. Une pièce pleine de surprises et de plaisirs. L’auteure Julie Aminthe publie cette pièce en 2014. Elle rejoint ce torrent qui déferle sur notre théâtre contemporain, parmi les Jean-Michel Ribes, Evelyne de la Chenelière, Pierre Notte, Jean-Marie Piemme ou Pierre Guillois, par exemple. Torrent d’où giclent et courent ces propositions folles et trash qui remuent la vie comme on remue la terre pour faire voir et entendre les quatre vérités de notre réalité. Sortes de miroirs savants qui nous aident à réfléchir par le média du rire. Dans cette pièce, les préparatifs d’un repas de fête obligeant une famille à rester groupée, permet à l’auteure d’en disséquer tous les possibles. Des névroses de chacun aux difficultés de la parentalité, en passant par les mensonges, les espérances et les crises qui fondent une famille ordinaire… Tout est bon pour montrer l’improbable par l’imaginaire. Ça implose, ça explose, ça expose et ça part dans tous les sens ! On sourit et on rit (il y en a même qui crie !) de s’être laisser prendre et surprendre par ce pataquès énorme. La mise en scène de Thibault Rossigneux joue des effets avec efficacité et habileté, le tout au cordeau. Les comédiens Pauline Dau, Philippe Girard, Elisabeth Mazev et Antony Roulier font du beau travail. Ils dépotent, ils assurent, ils impressionnent. Ils sont vraiment bons. Une peinture trash des détours et des contours de nos manies et de nos fantasmes (enfin, surtout des autres !). Un spectacle d’une qualité artistique remarquable. Incontournable !
Informations pratiques - Théâtre Silvia Monfort
Théâtre Silvia Monfort
106, rue Brancion 75015 Paris
- Métro : Porte de Vanves à 417 m (13)
- Tram : Brancion à 251 m (T3a)
- Bus : Morillons - Brancion à 126 m, Brancion - Morillons à 166 m, Fizeau à 186 m, Porte Brancion à 236 m, Vercingétorix - Paturle à 365 m
Plan d’accès - Théâtre Silvia Monfort
106, rue Brancion 75015 Paris