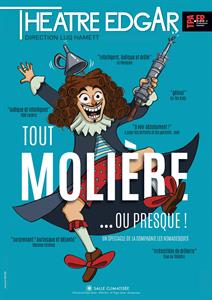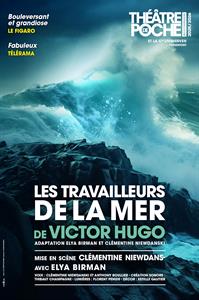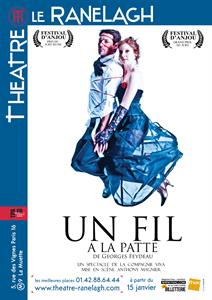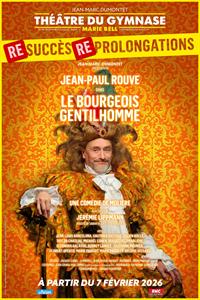Un trait de l'esprit
Un trait de l'esprit
- De : Margaret Edson
- Mise en scène : Jeanne Moreau
- Avec : Anna Gaylor, Anne Le Guernec, Ludmila Mikaël, Thierry Neuvic, Guilhem Pellegrin, Guillaume Clayssen, Séphora Haymann, Yohann Lucas, Stanislas Sauphanor
Sous le signe de l'exception
Un trait de l'esprit (extrait)
La maladie et ses métaphores
(extraits)
Sonnets sacrés (extrait)
"La mort de tout homme me diminue. Parce que je participe à l’humanité. Alors ne demande jamais pour qui sonne le glas ; il sonne pour toi." John Donne
Depuis plusieurs années, Jeanne Moreau rêvait de théâtre, cette scène où elle avait fait ses débuts (Comédie-Française, le TNP de Vilar…) et où, entre deux triomphes au cinéma, elle n’a cessé de revenir, comme pour retrouver ses racines d’actrice. Mais encore fallait-il trouver le projet susceptible d’emporter l’enthousiasme. Et là : surprise…
Jeanne Moreau a déniché une pièce américaine d’une force rare : Wit (Un trait de l’esprit pour la traduction) de Margaret Edson (Prix Pulitzer 1999). Elle a travaillé, en compagnie de Stéphane Laporte, à l’adaptation française du texte. Et pour défendre ce projet jusqu’au bout, elle va en signer la mise en scène : rien de moins que sa première mise en scène au théâtre !
Un trait de l’esprit se déroule en milieu hospitalier. Professeur de littérature anglaise, spécialisée dans les Sonnets Sacrés de John Donne (fascinant poète du dix-septième siècle), Vivian Bearing se trouve confrontée à un diagnostic terrible : elle a un cancer des ovaires. La pièce raconte alors l’évolution de la maladie, mais elle pose surtout la question du rapport que les êtres humains entretiennent face à elle. Il y a le problème de la distinction entre le "cas clinique" et la "personne". Il y a la tension entre ces couples apparemment antinomiques qui nous habitent tous : la science et les sentiments, le savoir et l’existence, le maître et l’élève, la fiction et la réalité, sans même parler de la vie et de la mort.
D’une écriture et d’un découpage incroyablement efficaces, Un trait de l’esprit s’impose comme une œuvre théâtrale d’une grande puissance dramatique. Elle est aussi, par les situations qu’elle propose, par les thèmes qu’elle aborde, l’occasion d’une plongée extraordinaire dans l’univers médical, quasi dans l’intimité du cancer.
La personnalité de Jeanne Moreau, le soin avec lequel elle s’entoure (décorateur, acteurs, etc) devrait faire de cette réalisation un spectacle marquant. Un véritable événement artistique et humain.
Un trait de l'esprit (extrait)
(Vivian Bearing fait un geste de la main. Le plateau s’éclaire graduellement. On
découvre que Vivian Bearing est grande, maigre et complètement chauve. Elle pousse un
pied à perfusion. Elle porte deux chemises d’hôpital l’une sur l’autre,
une casquette de base-ball et un bracelet d’identification de l’hôpital. Elle
s’adresse avec une familiarité feinte.)
Comment allez-vous aujourd’hui ? Bien ? Très bien.
(Avec le ton professoral qui lui est familier)
Ce n’est pas là mon entrée en matière habituelle, croyez-moi.
J’ai plutôt tendance à dire "salut" ou quelque chose d’un peu plus
classique, un peu moins indiscret.
Mais nous sommes dans une clinique, et "Comment allez-vous
aujourd’hui ?", c’est la formule courante.
Quant à la réponse convenable à ce genre de question, il y a là matière à
discussion. Est-ce qu’on répond "Je vais bien", en utilisant le verbe
aller, "Je vais", comme pivot copulatif qui lie le sujet, "Je", à son
complément, "bien"? Ou est-ce qu’on ignore la question et on répond
"ça va", et le sujet évite de préciser l’état dans lequel il se
trouve ? Je n’en sais rien.
Bref. Quand on me pose la question "Comment allez-vous aujourd’hui ?",
je réponds, "ça va".
Naturellement ça n’est pas tous les jours que "ça va".
On m’a déjà demandé : "Comment allez-vous aujourd’hui ?"
alors que je vomissais dans un haricot en plastique. On me l’a demandé, alors que je
refaisais surface après une opération de quatre heures, et que j’avais un tube
planté dans chaque orifice. "Comment allez-vous aujourd’hui ?".
La maladie et ses métaphores (extraits)
"La solution ne consiste pas à cesser de dire la vérité au malade, mais à rectifier l’idée que l’on se fait de cette maladie, à la démystifier."
"Qu’il s’agisse du cancer aujourd’hui ou de la tuberculose au siècle dernier, la résignation est unanimement dénoncée comme étant la cause directe de la maladie. On montre comment le malade devient résigné à mesure que le mal progresse."
"Si l’on a toujours de la peine à imaginer que la réalité d’une maladie aussi redoutable ait pu subir une transformation si radicale, il suffit de réfléchir à la déformation que produit à l’heure actuelle la pression née du besoin d’exprimer les attitudes romantiques à l’égard du soi. L’objet de la déformation n’est pas, bien sûr le cancer, une maladie que personne n’a jamais songé à rendre séduisante (encore qu’elle remplisse sur le plan des images certaines fonctions détenues par la tuberculose au XIXe siècle). Au XXe siècle, la maladie repoussante, déchirante, celle qui désigne une sensibilité supérieure et véhicule les sentiments "spirituels" et l’insatisfaction "critique", c’est la folie. (…)
Certaines caractéristiques de la tuberculose sont attribuées à la folie, l’idée par exemple que le malade est une créature fiévreuse et désordonnée, extrême et passionnée, un être trop sensible pour supporter les horreurs du monde vulgaire et quotidien. D’autres traits vont au cancer, les souffrances intolérables qui ne seront jamais romantiques. C’est la folie et non la tuberculose, qui véhicule le plus souvent aujourd’hui notre mythe séculaire d’auto transcendance. L’attitude romantique veut que la maladie exacerbe la conscience. Un rôle tenu naguère par la tuberculose, aujourd’hui par la folie qui, croit-on, portera la conscience au paroxysme et à l’illumination. Cette appropriation de la folie, cette fois par le romantisme, réfléchit avec un maximum de véhémence le prestige dont jouit à l’heure actuelle le comportement ("acting out") grossier (spontané) ou irrationnel, cette passion même dont on imaginait jadis qu’elle causait la tuberculose et que l’on croit être aujourd’hui à l’origine du cancer."
Susan Sontag
Le sida et ses métaphores
Christian Bourgois éditeur
Ne va t’enorgueillir, ô Mort, que l’on t’ait dite
Puissante et redoutable : tu ne l’es nullement,
Car ils ne meurent point ceux que tu crois abattre,
Pauvre Mort, et tu ne peux non plus me tuer
Du repos, du sommeil, tes images, nous vient
Grand plaisir : de toi donc un plus grand doit venir,
Et les meilleurs des hommes les premiers te rejoignent,
Paix de leurs cendres et de leurs âmes délivrance.
Du Destin, du hasard, des rois, du désespoir
Esclave, tu vis parmi poissons, guerres et maux,
Et charmes ou pavots donnent même sommeil,
Ou meilleur, que ton dard : pourquoi te rengorger ?
Après un court sommeil, c’est l’éveil éternel,
La mort ne sera plus : ô Mort, tu dois mourir !
Death be not pround, though some have called thee
Mighty and dreadfull, for, thou art not soe,
For, those, whom thou think’st, thou dost overthrow,
Die not, poore death, nor yet canst thou kill mee.
From rest and sleepe, which but thy pictures bee,
Much pleasure, then from thee, much more must flow,
And soonest our best men with thee doe goe,
Rest of their bones, and soules deliverie.
Thou art slave to Fate, Chance, kings, and desperate men,
And dost with poyson, warre, and sicknesse dwell,
And poppie, or charmes can make us sleepe as well,
And better then thy stroake ; why swell’st thou then ?
One short sleepe past, wee wake eternally,
And death sahll be no more ; Death, thou shalt die.
John Donne
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Chaillot - Théâtre national de la Danse
Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris
- Métro : Trocadéro à 96 m (6/9)
- Bus : Trocadéro à 31 m, Varsovie à 273 m, Pont d'Iéna à 301 m
Plan d’accès - Chaillot - Théâtre national de la Danse
1, Place du Trocadéro 75016 Paris