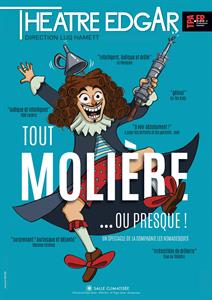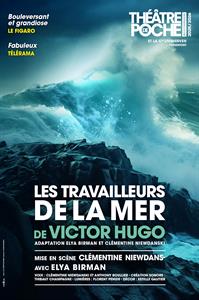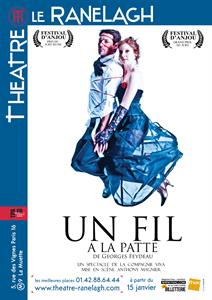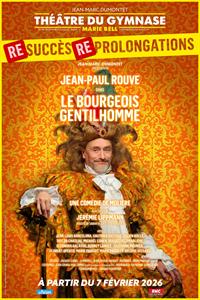Presque Don Quichotte
Presque Don Quichotte
- De : Jean-Claude Gallotta
- Mise en scène : Jean-Claude Galotta
- Avec : Hee-Jin Kim, Kae Kurachi, Solange Cheloudiakoff, Ximena Figueroa, Masa Sugiyama, Yannick Hugron, Ludovic Galvan, Thierry Verger, Benjamin Houal
Presque Don Quichotte
Ce qu’en pense la presse
Avant toute chose, avant tout spectacle, la scène du théâtre est nue, aride comme une terre sèche, où rien ne semble pouvoir pousser, pas le moindre geste, pas le moindre mot.
Puis soudain, surviennent de toutes parts, des silhouettes jetées, des corps sans ombre sous cent soleils, des illusions, des fantômes qui se révèleront être bientôt autant de corps réels, mobiles, à la chair éclatante, à l’énergie démesurée.
C’est le début d’une aventure, qui n’a pas encore de nom ni de destination, et qu’on appellera plus tard la danse.
Une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta est ainsi faite. On ne sait jamais d’où elle vient, quel est son village natal, quelles rencontres elle fera, quelles amours elle provoquera. C’est en se frayant son chemin qu’elle découvre son but, c’est en écoutant le choc des corps qu’elle déchiffre son rythme. Elle s’invente à mesure qu’elle s’écrit.
Cette nouvelle chorégraphie emprunte à Don Quichotte ses élans, ses toquades, ses combats chimériques, ses rêves d’amour. Comme lui, elle se rend capable de prouesses et de fatigues, de sublime et de grotesque, parcourue comme lui, sur toute la longueur de sa colonne vertébrale, par le sentiment tragique de la vie.
Nous sommes tous des chevaliers errants, dit-elle par solidarité avec tous ceux à qui on refuse le droit d’accéder à leurs rêves, le droit d’être ce qu’ils sont, là où ils sont, le droit d’être l’autre qu’ils ont envie d’être. La danse ne cherche pas le repos, elle milite pour l’homme et contre la haine qui le gagne. La danse cherche les ennuis.
Obstinément, Jean-Claude Gallotta poursuit son compagnonnage avec cette famille de héros inlassables dont Emile Dubois fut une ombre gigogne et Don Quichotte la figure de proue, de ces hommes qui ont su embrasser l’espace du monde à grands gestes et fouetter l’air devant eux pour ouvrir leur marche.
L’histoire raconte que, juchés sur leur propre monture, les interprètes de Jean-Claude Gallotta parcourent l’œuvre de Cervantès comme une lande qui s’étend jusqu’à nos jours. Mais les temps ont changé. A la croisée de l’imaginaire et du réel, du geste et de la parole, ils rencontrent souvent la réalité. La dure, la vraie, l’inévitable, l’indéguisable. Don Quichotte avait presque raison, aujourd’hui les géants ont succédé aux moulins à vent. La bataille sera furieuse et inégale.
Claude-Henri Buffard, mai 1998.
… « Prenez le plateau de la Mancha avec Don Quichotte et son Sancho, soufflez sur ces deux silhouettes reconnaissables entre toutes et vous vous retrouvez avec un trou béant qu’il s’agit de remplir ». Cette confidence de Jean-Claude Gallotta vaut comme avertissement à tout spectateur de Presque Don Quichotte. Tout est donc dans ce « Presque » (….) Secouer, relancer, déstabiliser. Quand la fièvre grimpe, les corps lâchent. Ils tremblent, sautillent comme des boxeurs trop nerveux, tournoient et galopent avec une vitalité enfantine. Ces déflagrations disent haut le désir de Jean-Claude Gallotta de secouer ses habitudes, de relancer sa donne… Ainsi ce virtuose des circulations éclatées et des contrepoints se plait-il, cette fois-ci, à rassembler ses troupes dans des danses frontales, des unissons en guirlandes.». Le Monde, Rosita Boisseau, Février 1999
« Presque Don Quichotte ? Non, tout à fait !(…). En combinaisons blanches ou pyjamas à rayures, ils s'en donnent à cœur joie à force de duos tendres et loufoques, de courses ludiques, d'étonnements naïfs et de sympathie violente: l’esprit Gallotta quoi !. Nul besoin de la silhouette du célèbre hidalgo. Son assurance en ses chimères est bien partagée. Telle cette danseuse qui, sur la pointe des pieds, laisse tomber le buste pour regarder le monde entre ses jambes, la tête en bas. L’un claudique jambe raide à la traîne, l’autre chevaleresque, emboîte le pas cordialement. Une belle séquence où les danseurs roulent autour de la scène serrant des livres sur leur cœur, évoque la lecture boulimique, folie et délectation. » Danser, B. Bonis, mars 1999.
«Il y a tout Gallotta dans ce « Presque Don Quichotte », sa désespérance, sa loufoquerie, sa fantaisie, sa bonhomie aussi. » Libération, M.-C. Vernay, 1999.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Informations pratiques - Maison des Arts à Laon
Maison des Arts à Laon
place Aubry 02000 Laon