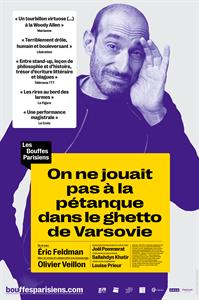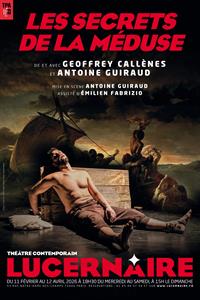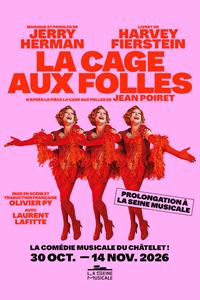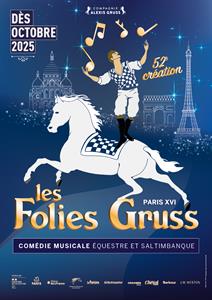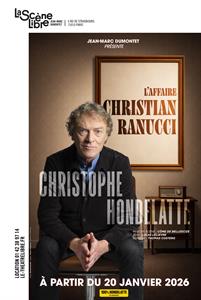Le Maître et Marguerite
Le Maître et Marguerite
Coup de cœur de la rédaction Le 20 septembre 2019
- De : Mikhaïl Boulgakov
- Adaptation : Igor Mendjisky
- Mise en scène : Igor Mendjisky
- Avec : Marc Arnaud, Igor Mendjisky, Alexandre Soulié, Esther Van den Driessche, Yuryi Zavalnyouk, Pauline Murris, Marion Dejardin, Adrien Melin, Gabriel Dufay, Pierre Hiessler
Le Maître et Marguerite - Photographies
À partir de 14 ans.
- Roman mythique sur scène
Le Diable est en visite dans le monde. Et autour de Woland – c’est son nom – s’entre-tissent trois récits : l’un relate la sinistre sarabande dans laquelle Moscou, dans les années trente, se trouve entraînée ; l’autre, l’amour du Maître pour Marguerite et un troisième, l’histoire de Ponce Pilate, dont la rédaction a rendu fou ledit Maître…
Dans ce monde à la fois tragique et burlesque, les chats parlent, les démons paradent et chaque figure peut comporter un redoutable envers.
Juxtaposant les époques, emboîtant les récits, convoquant la tradition chrétienne et le mythe de Faust, alternant scènes réalistes et fantasmagoriques, alliant l’abject et le sublime - celui de l’amour de Marguerite -, Boulgakov constuit un univers parodique, carnavalesque. Woland, l’illusionniste, organise, pour une société sous hypnose collective, le spectacle de l’apocalypse grandiose où se déploient et l’horreur et le miracle de la vie. Le Diable a deux visages : en jouant de la réversibilité du bien et du mal, il est capable de semer la violence et l’effroi, comme de créer l’étincelle qui, dans un monde figé, donne naissance à l’amour et à la création. La liberté souveraine de l’imagination fait échec à la folie meurtrière de l’ordre imposé.
- La presse
« Dans une mise en scène imagée et dépouillée, Igor Mendjisky livre du Maitre et Marguerite, de Boulgakov, une adaptation parfaite. » Gilles Costaz - Politis
« Porté par l'amour profond qu'Igor Mendjisky porte au chef-d'œuvre, inspiré par sa culture russe, il a réussi une adaptaptation idéale pour le type de théâtre qu'il aime pratiquer. Un théâtre de tréteaux, un peu forain, un théâtre carnavalesque et poétique. […] Nous aussi, on s'envole. » Armelle Héliot - Le Figaro
« Cette pièce déborde de partout, comme le roman dont elle est tirée, roman mythique écrit et réécrit, des années durant. Le spectateur, lui, sort de là sur un nuage. Deux heures sans une seconde d'ennui. Des comédiens formidables. Evidemment, de retour chez soi, on se jette sur le roman. » Jean-Luc Porquet - Le Canard Enchaîné
« Quelle aventure ! Quel exploit ! Quelle réussite ! […] Si le roman a été un « choc » pour Igor Mendjisky, la représentation théâtrale l’a été aussi pour nous. » MarCel - Le Monde
« Virtuose, hachée, profondément drôle et intensément cohérente sous les apparences, la représentation joue à cache-cache avec l’imaginaire. » Jean Grapin - La Revue du Spectacle
« Un spectacle à l’énergie foisonnante […] la mise en scène est endiablée. » Stéphane Capron - Sceneweb
« Le pari d’Igor Mendjisky et de sa bande est une belle réussite, il mène tambour battant ces différentes histoires avec des comédiens très justes et talentueux. » Davi Juca - Le Souffleur
« Rendez-vous très malin avec le malin. » L'Humanité, juin 2019
« Avec ce cabaret dédié à l’illusionniste de génie qu’était Boulgakov, Igor Mendjisky nous gratifie en close-up d’un formi-dable exercice de style apte à séduire toutes les générations. » Les Inrockuptibles, mars 2018
- Note d'intention
Mikhail Boulgakov écrivit dans le secret de son cabinet, de 1928 à 1940, un texte d’abord intitulé Le Spécialiste au pied fourchu, puis Roman sur le diable, puis Roman fantastique, puis Le Prince des ténèbres ; repris dès le début des années 1930, le projet de Roman sur le diable s’enrichit d’un nouveau personnage, lui aussi écrivain, qui va déterminer la structure et le titre définitifs de cette œuvre-somme : Le Maître et Marguerite.
Le roman de Boulgakov est un choc. C’est un bloc protéiforme mystérieux qui résonne en moi depuis longtemps comme une ritournelle, une musique venue de l’enfance ou plutôt une symphonie étrange mêlant le sublime et le chaos. Boulgakov crée un espace de narration à mi-chemin entre l’inconnu et l’éternellement familier. En convoquant les grands mythes comme celui de Faust, il nous mène sur un parcours que nous croyons connaître. Mais tout d’un coup l’opacité, la folie et la grandeur des songes se mêlent à tout ça. Le diable tutoie les mythes modernes de la société de consommation, il réinterroge la notion de bien et de mal. Le poète fou dialogue avec un chat et croise une sorcière sur le bord d’une route banale. Boulgakov nous réconcilie avec la magie des légendes. Il nous rappelle qu’aujourd’hui encore, il est possible de déplacer les frontières de la réalité.
Ce sont ces limites floues entre fiction et réalité, entre classique et moderne, qui m’ont incité à adapter ce roman. Boulgakov savait pertinemment qu’il ne verrait pas son roman publié de son vivant, il s’est donc tout permis sans aucune retenue. C’est cette audace que je chercherai, ce cri de liberté qu’on nous oblige parfois à taire. Le spectacle sera joué en tri-frontal. Comme Le maître, on y parlera le français, le russe – qui m’est cher – et certainement l’araméen ou l’hébreu, langues que parlait le Christ.
Nous chanterons, Marguerite dansera et volera ; le diable fera tomber une pluie de libertés et nous tenterons tous de proclamer à l’unisson que chacun se doit d’épouser souverainement la vie... Si le Le Diable est en visite dans le monde. Et autour de Woland – c’est son nom – s’entretissent trois récits : l’un relate la sinistre sarabande dans laquelle Moscou, dans les années trente, se trouve entraînée : meurtres, exactions, enlèvements, incendies ; le deuxième, l’histoire d’un écrivain anonyme, le Maître, en institution psychiatrique pour avoir écrit un roman sur Ponce Pilate - sorte d’évangile apocryphe qui relate l’impossible dialogue entre Yeshoua (le Christ), et le « préfet » de Judée Ponce Pilate ; et le troisième, l’histoire d’amour entre le Maître et Marguerite - qui sauve l’écrivain au moment où il abjure son œuvre pour rejoindre avec lui « la maison qui est la leur de toute éternité ».
Dans ce monde à la fois tragique et burlesque, les chats parlent, les démons paradent et chaque figure peut comporter un redoutable envers. Juxtaposant les époques, emboîtant les récits, convoquant la tradition chrétienne et le mythe de Faust, alternant scènes réalistes et fantasmagoriques, alliant l’abject et le sublime - celui de l’amour de Marguerite -, Boulgakov constuit un univers parodique, carnavalesque. Woland, l’illusionniste, organise, pour une société sous hypnose collective, le spectacle de l’apocalypse grandiose où se déploient et l’horreur et le miracle de la vie. Le Diable a deux visages : capable de semer la violence et l’effroi, il peut aussi créer l’étincelle qui, dans un monde figé, donne naissance à l’amour et à la création. La liberté souveraine de l’imagination fait échec à la folie meurtrière de l’ordre imposé.
Le monde de Boulgakov ressemble par moments à la réalité, il n’en a que les atours : c’est un semblant revendiqué. L’atmosphère, chez Boulgakov, est celle d’un rêve ou d’un cauchemar. Alors, tout est possible dans cet impossible. Pour être tout à fait sincère, il me semble presque utopique de faire une pièce de théâtre de l’histoire du Maître et Marguerite.
Il y a tant de personnages, tant de scènes fantastiques et d’événements écrasants dans un temps si court... et pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai la conviction qu’avec de la créativité, avec l’amour que je porte à cette histoire, avec l’inventivité des acteurs, l’adaptation que nous proposerons rejoindra ce qui m’a bouleversé dans le récit. L’histoire est magnifique, l’univers est sans limite ; c’est une fresque d’une originalité enivrante et contemporaine. On y trouve du sacré et du brut ; c’est un mélange entre tragédie antique et conte fantastique ; c’est une histoire pleine de vie, de rêves ; c’est une histoire d’amour entre un auteur et une fleur, un manifeste pour la liberté, accessible à des enfants...
C’est un voyage fabuleux qui se doit d’être accompli " avec " les spectateurs. Il y a toujours une petite note dissonante chez Boulgakov qui nous éloigne un peu du vrai, sans pour autant nous égarer dans le fantastique. On est à la limite, à la frontière, dans le presque... La scène peut tout accepter d’un tel récit car sa logique est à l’intérieur. Il n’y a que le flux des vivants qui fait sens. Un travail de lisière en somme, comme à l’orée d’un bois étrange et attirant.
Igor Mendjisky
Le roman qu’écrit le Maître est un nouvel Evangile, la relation véridique de l’histoire du Christ et de Ponce Pilate, à la différence de la version canonique, qui se présente comme une interprétation erronée des paroles du Maître par des disciples dévoués, mais ignares. « Je n’ai absolument rien dit de tout ce qui est noté là », dit Yeshua le héros du roman du Maître, après avoir lu les notes prises par Matthieu Levi. Ce roman et son auteur sont violemment pris à partie par la critique qui exige qu’on en finisse avec le « pilatisme » ; des membres de l’influente et prospère organisation littéraire Massolit se proposent d’écrire une œuvre antireligieuse qui refuterait jusqu’au fait même de l’existence du Christ. Poussé à bout par les persécutions, les privations et les menaces d’arrestation, le Maître brûle son manuscrit, c’est-à-dire agit comme Boulgakov lui-même avec son roman pendant la crise de 1930, dont les circonstances rappellent à bien des égards les infortunes du Maître. Par là-même, le Maître trahit son héros en refusant de défendre cette vérité sur lui qu’il est seul à connaître ; la folie du Maître et sa tentative de suicide rappellent le sort d’autres héros de Boulgakov torturés par un sentiment de culpabilité après avoir commis une trahison...
Au moment où la catastrophe semble totale et la mort inéluctable, le Maître reçoit l’aide d’une force mystérieuse et toute-puissante, celle du diable (Woland) qui vient d’arriver à Moscou. Woland rend au Maître son manuscrit qui s’est avéré indestructible : « Les manuscrits ne brûlent pas ». Il châtie le critique Berlioz, président de la Massolit, en le condamnant au néant pour son incroyance... et cette mort devient le symbole de l’anéantissement de tout un monde dont Berlioz est l’incarnation. Mais Woland et ses acolytes tuent également le Maître et Marguerite : les délivrant de ce monde hostile, et condamné, ils les transportent dans l’au-delà pour les installer dans un « refuge » idyllique. Ce dénouement reflète la conception typiquement boulgakovienne du créateur « faustien » qui réunit en lui des traits du messie, de la victime expiatoire et du traître et n’est capable d’assumer sa mission que grâce à l’appui et à la protection d’une force impure.
B. Gasparov, Histoire de la littérature russe, Le XXe siècle, Fayard
Sélection d'avis des spectateurs - Le Maître et Marguerite
Le Maitre et Marguerite Par claudineP - 12 juin 2018 à 10h28
excellent spectacle, très visuel, très inventif. Le texte (très dense, touffu) est ici rendu plus lisible, plus accessible. l'acteur qui joue le diable est stupéfiant.
Réservé via Theatreonline
Bravo ! Par Jeanne A. - 11 juin 2018 à 09h05
Mise en scène et jeux d'acteurs remarquables , un humour décoiffant par moments, merci pour ce beau théâtre !
Réservé via Theatreonline
Un effort louable Le 10 juin 2018 à 22h07
Difficile pari d'adapter un tel roman ! J'ai eu du mal à retrouver l'humour caustique du livre mais le travail effectué par le metteur en scène et l'interprétation des acteurs sont tout de même à féliciter.
Réservé via Theatreonline
Du très beau théatre ! Le 10 juin 2018 à 15h41
A partir d'un pari très risqué, d'adapter ce roman au théâtre, le directeur acteur présente une pièce avec une créativité et une mise très belle mise en scène, avec des acteurs remarquables. Ma plus belle pièce de l'année.
Réservé via Theatreonline
le maitre et marguerite Par Sylvie J. - 10 juin 2018 à 11h47
Excellent spectacle, remarquable par sa mise en sène, fluide, qui permet de suivre les péripéties d'un roman complexe où plusieurs récits s'entrecroisent. Excellents apports des parties musicales, et de la technologie, intervention intéressante des spectateurs qui restitue la contemporanéité de la présence du Mal. Interprétation un peu hétérogène toutefois, Marguerite crie un peu trop....mais lgor Mendjisky est remarquable dans ses 2 rôles.
Réservé via Theatreonline
Le 8 juin 2018 à 10h20
Dommage d'avoir privilégié l'anecdotique au détriment de la controverse et d'avoir fait de ce texte dense, drôle et passionnant une gentille comédie un peu loufoque. Pas mal de faiblesses de rythme. Bon comédiens et belle mise en scène mais je n'y ai pas du trouvé mon compte.
Réservé via Theatreonline
Le Maître et Marguerite Par PHILIPPE C. - 7 juin 2018 à 13h01
Mise en scène audacieuse et correspondant plutôt bien à l'esprit de cette histoire complexe. Traiter cette histoire en une heure et demi est ici un pari réussi. Et les acteurs sont (presque) tous très bons. Un grand MERCI aussi à l'équipe du théâtre du Soleil qui a parfaitement et très aimablement répondu à mon handicap.
Réservé via Theatreonline
un bémol Par Irina K. - 7 juin 2018 à 09h48
Dans la distribution j'ai beaucoup apprécié Woland, Ivan, Behemot...(dommage - quand c'est joué en alternance comment savoir qui joue?). Moins apprécié Marguerite...j'aurais aimé un souffle plus romantique pour ce personnage.
Réservé via Theatreonline
Moyenne des avis du public - Le Maître et Marguerite
Pour 32 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Le Maitre et Marguerite Par claudineP (19 avis) - 12 juin 2018 à 10h28
excellent spectacle, très visuel, très inventif. Le texte (très dense, touffu) est ici rendu plus lisible, plus accessible. l'acteur qui joue le diable est stupéfiant.
Réservé via Theatreonline
Bravo ! Par Jeanne A. (1 avis) - 11 juin 2018 à 09h05
Mise en scène et jeux d'acteurs remarquables , un humour décoiffant par moments, merci pour ce beau théâtre !
Réservé via Theatreonline
Un effort louable Le 10 juin 2018 à 22h07
Difficile pari d'adapter un tel roman ! J'ai eu du mal à retrouver l'humour caustique du livre mais le travail effectué par le metteur en scène et l'interprétation des acteurs sont tout de même à féliciter.
Réservé via Theatreonline
Du très beau théatre ! Le 10 juin 2018 à 15h41
A partir d'un pari très risqué, d'adapter ce roman au théâtre, le directeur acteur présente une pièce avec une créativité et une mise très belle mise en scène, avec des acteurs remarquables. Ma plus belle pièce de l'année.
Réservé via Theatreonline
le maitre et marguerite Par Sylvie J. (1 avis) - 10 juin 2018 à 11h47
Excellent spectacle, remarquable par sa mise en sène, fluide, qui permet de suivre les péripéties d'un roman complexe où plusieurs récits s'entrecroisent. Excellents apports des parties musicales, et de la technologie, intervention intéressante des spectateurs qui restitue la contemporanéité de la présence du Mal. Interprétation un peu hétérogène toutefois, Marguerite crie un peu trop....mais lgor Mendjisky est remarquable dans ses 2 rôles.
Réservé via Theatreonline
Le 8 juin 2018 à 10h20
Dommage d'avoir privilégié l'anecdotique au détriment de la controverse et d'avoir fait de ce texte dense, drôle et passionnant une gentille comédie un peu loufoque. Pas mal de faiblesses de rythme. Bon comédiens et belle mise en scène mais je n'y ai pas du trouvé mon compte.
Réservé via Theatreonline
Le Maître et Marguerite Par PHILIPPE C. (2 avis) - 7 juin 2018 à 13h01
Mise en scène audacieuse et correspondant plutôt bien à l'esprit de cette histoire complexe. Traiter cette histoire en une heure et demi est ici un pari réussi. Et les acteurs sont (presque) tous très bons. Un grand MERCI aussi à l'équipe du théâtre du Soleil qui a parfaitement et très aimablement répondu à mon handicap.
Réservé via Theatreonline
un bémol Par Irina K. (6 avis) - 7 juin 2018 à 09h48
Dans la distribution j'ai beaucoup apprécié Woland, Ivan, Behemot...(dommage - quand c'est joué en alternance comment savoir qui joue?). Moins apprécié Marguerite...j'aurais aimé un souffle plus romantique pour ce personnage.
Réservé via Theatreonline
une étoile qui danse Par JEANA (5 avis) - 7 juin 2018 à 09h28
Une formidable mise en scène et d'excellents comédiens qui ont encore du chaos en eux. On en oublie le confort très relatif de la salle. N'ayant pas (encore) lu le livre, je n'ai pas regretté d'avoir pris connaissance de l'argument avant ( même si je sais qu'il y a plusieurs écoles) Bravo la cartoucherie!
Réservé via Theatreonline
Le 3 juin 2018 à 22h20
Difficile d’apprécier un spectacle dans une salle où il fait 40 degrés. Les acteurs sont bons mais la pièce est complexe quand on n’a pas lu le livre. Les intermèdes faisant intervenir des membres du public sont longs et lourds
Réservé via Theatreonline
Le 3 juin 2018 à 15h51
Exaltant, vous n'avez jamais vu un tel diable ni un tel chat. Et la mise en scène est sublime.
Réservé via Theatreonline
Une thérapie d’intelligence Le 3 juin 2018 à 14h39
Et si le diable avait de l’humour? Et que le message du Christ n’ér Pas celui qu’on croît? Un texte magnifique servi par une mise en scène dense, subtile et des acteurs superbes. Du très très bon théâtre !
Réservé via Theatreonline
A voir ! Le Maître et Marguerite Le 2 juin 2018 à 18h59
Une soirée ou pas une seconde l'attention ne s'est perdue; une mise en scène qui rend fluide l'enchaînement des scènes. La projection sur 3 écrans des traductions des textes grec et russe ne m'ont pas perturbée (plutôt charmée par la sonorité des langues) Un metteur en scène (Igor Mendjisky) très créatif et une belle équipe de comédiens. Et comme beaucoup je vais lire Boulgakov. Une note spéciale au Théâtre de la Tempête que je ne connaissais pas : un lieu d'une grande convivialité dans lequel je reviendrai avec plaisir.
Réservé via Theatreonline
Le Maître et Marguerite !!! Par Catherine H. (3 avis) - 2 juin 2018 à 11h02
Très bien joué, belle occupation de l'espace scénique. le texte politico, religioso, russo coincé, rétro ne m'a pas emballé mais il a été très bien mis en valeur par le metteur en scène et les comédiens. catherine Hallier
Réservé via Theatreonline
un peu trop vieux théatre politique des années 70. émotion manque. Par Maryvonne G. (2 avis) - 1er juin 2018 à 16h38
avons aimé les 2 fous ( bons comédiens qui nous ont procurés de l'émotion). mais l'ensemble inutilement trop long. par exemple 2° partie puérile scêne de la sorcière.passer rapidement avec une voix off et vidéo aurait largement suffi . mise en scêne trop démonstrative , donneuse de leçons , . adaptation du livre pesante . le chanteur final superbe .
Réservé via Theatreonline
Informations pratiques - Théâtre des Bergeries
Théâtre des Bergeries
5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec
- RER : Noisy-le-Sec à 739 m (E)
- Tram : Gare de Noisy-le-Sec à 727 m (T1)
- Bus : Marché des Découvertes à 113 m, Jeanne d'Arc à 113 m
-
Métro Ligne 11, station Mairie des Lilas, puis bus 105, arrêt place Jeanne d’Arc (Mairie) ; ligne 5, arrêt Raymond Queneau, puis bus 145 arrêt Jeanne d’Arc ou arrêt Bobigny – Pablo Picasso, puis bus 301, arrêt Jeanne-d’Arc.
Voiture (prévoir stationnement dans les rues alentours, parking payant à la Gare de Noisy-le-Sec à 8 minutes à pied du théâtre) :
Autoroute A3 de la Porte de Bagnolet vers Lille, 100 m à droite après le panneau Villemonble, suivre la direction Rosny Centre Commercial, puis Noisy-le-Sec Gare. Face à la gare, prendre à gauche la rue Jean-Jaurès. Accès facile à partir de la Porte des Lilas ou de la Porte de Pantin par Romainville.
Plan d’accès - Théâtre des Bergeries
5 rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec