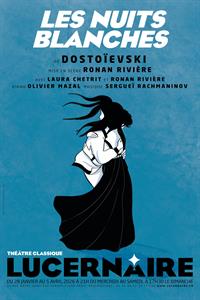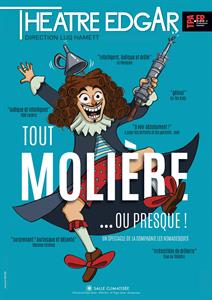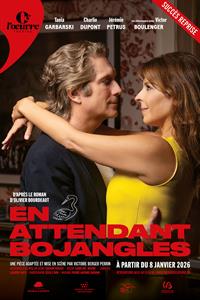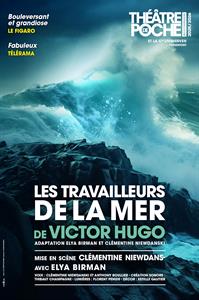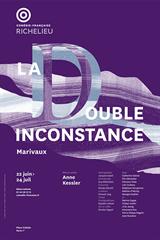
La Double inconstance
La Double inconstance
Coup de cœur de la rédaction Le 23 juin 2017
La Double inconstance - Photographies
- L'inconstance du monde
Silvia et Arlequin se portent un amour pur et réciproque, mais le Prince a jeté son dévolu sur la jeune villageoise. Il la fait enlever, la garde en son palais, et livre les amants à Flaminia pour qu’elle mette en oeuvre la machination de la double inconstance. Pas à pas, les amoureux sont pris au piège d’une mise en scène habilement menée sans jamais s’apercevoir qu’ils en sont les acteurs, ou les marionnettes. Silvia se laisse séduire par un officier qui se révélera être le Prince tandis qu’Arlequin tombe sous le charme des paroles de Flaminia. Un couple défait en donne deux.
L’amour qu’on pensait éternel cède le pas au temps du plaisir éphémère. Le monde rural, rustique, pauvre et impuissant ne résiste pas à la corruption de la cour, de la coquetterie, de la richesse et des honneurs. L’inconstance du monde, son instabilité, contamine qui croit être fidèle à ses émotions et pense n’être que le spectateur de ce déséquilibre sans y participer.
Marivaux (1688-1763) donne La Double Inconstance au Théâtre-Italien en 1723. À 35 ans, il est journaliste et l’auteur reconnu de plusieurs pièces et romans. La Comédie- Italienne a déjà monté avec succès trois de ses pièces, dont La Surprise de l’amour, tandis que sa première tragédie, Annibal, a chuté au Théâtre-Français. La Double Inconstance est l’objet d’un compte rendu détaillé du Mercure, qui montre que la version que nous connaissons diffère de celle qui fut interprétée à la création. La « métaphysique du coeur » frappa les contemporains plus que la représentation des relations sociales. Le jeu de l’actrice Silvia, muse de Marivaux, est pour beaucoup dans le succès de la pièce qui ne quitte plus le répertoire des Italiens jusqu’en 1757, avant de disparaître totalement de la scène pendant un siècle et demi. La Comédie-Française la fait entrer au répertoire en 1934.
Pour sa première mise en scène à la Salle Richelieu, Anne Kessler présente La Double Inconstance, pièce de contrastes, lumineuse et sombre, joyeusement tragique. Pour elle, le théâtre de Marivaux apporte à l’acteur une sensation de virtuosité grisante, l’expérience d’une sensibilité exacerbée, et plus particulièrement dans cette pièce qui livre les personnages à l’expérimentation sentimentale. Un spectacle qu’Anne Kessler souhaite inscrire dans la particularité du rapport au public de la salle à l’italienne, un rapport proche et intime avec l’oeuvre de Marivaux.
- La presse
« Salle Richelieu, Anne Kessler fait de la « Double Inconstance » un joyeux manifeste, un « work in progress » situé dans un foyer des artistes - style Comédie-Française... (…) Anne Kessler aurait pu la tirer davantage vers la noirceur, elle a préféré en exalter la malice et la gaieté. Sa démarche est servie par une distribution de haut vol. » Philippe Chevilley, Les Echos, 9 décembre 2014
« Il y a, à chaque instant, un art très inventif de nous rappeler à la réalité quand nous sommes dans un rêve (...) et de nous rappeler à la fiction quand nous sommes dans le quotidien de la vie. Dans ce goût des changements d'angle et de perspective, tous les coups sont permis (...) » Gilles Costaz, Le Point, 10 décembre 2014
« Ecouter Marivaux est un pur enchantement. Les comédiens-français le disent au soupir près. C'est d'une beauté grisante : une langue fluide et vive, une langue pour la simplicité et pour le sublime, une langue concrète et lestée de mille et une significations secrètes. Car c'est l'âme qui parle, par-delà la condition sociale, c'est l'instinct, libre et audacieux de chacun. Et cela fait des étincelles ! (...) L'interprétation est éblouissante. » Armelle Héliot, Le Figaro, 5 décembre 2014
« De la mise en scène délicate d'Anne Kessler, bourrée d'idées poétiques ou cocasses, on retient moins la curieuse mise en abyme – ce seraient des acteurs répétant la pièce dans un décor miroir de la Comédie-Française... – qu'une façon subtile, assez sensuelle, d'étirer le temps. Cette langueur conduit naturellement les personnages à baisser leur garde et donne à entendre merveilleusement le texte. Il faut dire que la troupe est ici à son meilleur : Loïc Corbery et Florence Viala menant le bal, bien soutenus par de jeunes comédiens épatants. » Aurélien Ferenczi, Télérama TTT
« Le couple est une fiction ; il ne survit qu’en résistant à d’autres fictions. Anne Kessler met en scène le frottement sensuel entre ces fictions avec une inventivité joyeuse, vive, merveilleusement désordonnée par ses excès. La jeunesse des personnages est portée par celle des acteurs. C’est le jeu de l’amour et des regards. (...) La magie instantanée du spectacle ne serait rien sans les acteurs qui jaillissent du chapeau, tout en trompe-l’œil et trompe-le-cœur. » Philippe Lançon, Libération, 17 décembre 2014
- Note d'intention
Je retrouve La Double Inconstance que j’avais travaillée dans le rôle de Silvia avec Antoine Vitez, mon professeur à l'école de Chaillot. C'est avec cette pièce que j'ai rencontré Marivaux, que j'ai commencé à l'aimer et en l'aimant que j'ai compris que sa parole, que son théâtre allait bien au-delà des mots. Pour rendre compte par la mise en scène de la force de l'œuvre, il faut dépasser la musique du texte, surmonter l'émerveillement de la phrase et parvenir, avec les acteurs, au sens.
Bien souvent, on ne le perçoit qu'en situation de jeu. Après de nombreux va-et-vient du plateau à la table, de l'action à l'analyse, qui chez Marivaux, comme chez tous les savants du XVIIIe siècle, sont indissociables. Je dis « savant » car, chez ce maître du théâtre, l'expérience est au cœur du processus de création et, plus encore, elle est l'objet de l'œuvre. La Double Inconstance propose de soumettre le couple le plus uni, le plus solide, le plus homogène, le plus amoureux à une somme de contraintes sociales et psychologiques pour mesurer sa résistance et déterminer la position de son point de rupture.
Pour l'intérêt de l'expérience et pour que ses conclusions soient pertinentes, il est essentiel que rien dans son protocole – c'est-à-dire dans la mise en scène – ne soit artificiel. Commencer à plat. Ne pas précipiter les mouvements d'humeur, d'émotion. Ne pas « raconter ». Laisser progresser l'histoire malgré nous. Créer les conditions favorables à l'expression des phrases de l'auteur. Reconstituer les situations extrêmes auxquelles sont soumis les héros de la pièce et amener, par cette reconstitution, les acteurs à retrouver les réactions impulsives des personnages. C'est la situation qui les pousse aux accès de violence, et qui détermine l'impact... la vérité d'une réplique, le fait qu'elle « passe », et qu'on l' « entende ».
Marivaux a noté les mots avec une précision toute scientifique Avec exactitude et rigueur. Ce théâtre n'est plus celui de la tradition de l'acteur roi, mais de celle de l'auteur roi, de l'observateur éminent, du docteur en émotions humaines. Le siècle de Marivaux est celui de la science, celui de la volonté affirmée de comprendre le monde pour énoncer clairement les règles qui le régissent. L'auteur dramatique va prendre sa part du travail pour atteindre cet objectif.
Contrairement à certaines pièces où Marivaux manie des formes de langue très différentes selon l'origine sociale des personnages, dans La Double Inconstance, maîtres et valets s'expriment à peu près de la même façon. On a la sensation d'avoir affaire à des personnages presque à égalité, si l'on excepte le Prince. Cette égalité-là rend compte de l’effet miroir de la pièce, et souligne les situations doubles qui la traversent. Il ne s'agit pas d'une pièce dont le thème est l’inné et l’acquis, comme Le Jeu de l'amour et du hasard. Ici, nous sommes dans une pastorale idyllique où s'accordent dans l'amour puissants et serviteurs. J'emploie le mot « idyllique » pour désigner une forme d’abstraction. Quand Marivaux écrit que l'action se situe dans le palais d’un prince, il affirme que la réalité du lieu importe peu ou, plus exactement, que le réalisme n'est pas une garantie de vérité. Ce que la réalité transposée dans la pièce doit nous apprendre c'est que nous sommes moins les valets de nos maîtres que ceux de nos sentiments. Nous pensions les dominer, ce sont eux qui nous gouvernent. Pis encore, nous pensions pouvoir leur faire une absolue confiance et voilà qu'ils nous trahissent. C'est ce que nous apprend l'expérience en nous montrant, dans le spectacle, les personnages perdre pied peu à peu.
Cette « psycho-chimie » n'est pas affranchie des contraintes des sciences exactes. Il lui faut des catalyseurs. Ici, c'est le Prince qui en fait fonction : sans lui, pas de réaction. Au terme de l'expérience, Flaminia qui en est une des composantes essentielles, est profondément transformée. En revanche, le catalyseur, le Prince, comme en chimie, ne subit aucune modification au terme du processus réactionnel. S'il passe par de nombreux états d'âmes contradictoires, il revient, à la fin, à sa position première. L'auteur propose à l’acteur mille humeurs, mille tourments, mille changements physiques et le rétablit, à l'issue de la preuve par l'expérience, dans son état initial.
Je crois qu'avec La Double Inconstance, Marivaux veut raconter l’histoire d’un complot ; or rien ne ressemble davantage à un complot que la création d’un spectacle. On y complote pour le bonheur du spectateur. On répète, encore et encore, en secret, comme si l'on travaillait dans un laboratoire. Il me semblait qu’il pouvait y avoir un lien entre les préparatifs d’un mariage et les préparatifs d’un spectacle, et j'ai voulu explorer ce parallélisme de la création. Je me suis bien sûr attachée à cette phrase de Marivaux que tout le monde connaît : « l’acteur, c’est celui qui fait semblant de faire semblant. » Et à cette autre : « si on me traitait d’homme d’esprit, j'en serais heureux, mais rien ne me ferait davantage plaisir que si on disait de moi que j'ai corrigé quelques vices chez certains de mes contemporains. »
Le rôle du théâtre, selon Marivaux, c'est de décrire sans dénoncer, c'est d'exposer sans juger, c'est d'observer sans trahir et c'est surtout de révéler sans chercher à convaincre. La science dramatique est un humanisme. Le décor de Jacques Gabel montre le foyer des artistes, comme une petite place où l'on assiste à la transformation de l'acteur en personnage. Le spectacle joue un double jeu en proposant une scénographie qui utilise un lieu de répétition, un lieu du XVIIIe siècle, mais un lieu d'aujourd'hui. L'espace de Marivaux va se créer devant les spectateurs ; ils croiront d'abord être propulsés deux cent cinquante ans en arrière, alors que non, ce qu'ils verront, c'est le Foyer des artistes, dans sa configuration actuelle. Pour moi, cela exprime le fait que c'est à la Comédie-Française que cette pièce est montée ; je veux montrer des acteurs de la troupe en train de répéter un spectacle pour des spectateurs d'aujourd'hui. Des spectateurs d'un monde qui lui aussi se complexifie. Les costumes des acteurs, pendant le spectacle, vont suivre le processus que connaissent les costumes lors d'une création. Ce seront d'abord des leurres, puis on oscillera entre ces leurres et les costumes « finis » ; ils ne seront prêts qu'à la toute fin, au moment où le spectacle est sur le point d'avoir lieu : ce spectacle, c'est le mariage du Prince avec Silvia, d'Arlequin avec Flaminia. Un mariage double, comme est double l'inconstance qui fait le titre de la pièce.
Anne Kessler, octobre 2014
Propos recueillis par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française.
Sélection d'avis des spectateurs - La Double inconstance
La double inconstance Par Christophe B. - 28 juillet 2017 à 12h14
Une mise en scène enjouée, rythmée et virevoltante, qui fait la part belle au texte Marivaux dont on redécouvre avec joie, toute la richesse et la complexité. Extraordinaire mise en abime théâtrale de ce jeu de masques et d'apparences dont la vie nous fait à la fois pour notre plus grand bonheur les complices et victimes consentantes. Bravo aux comédiens du Français qui, dans ce jeu de dupes vertigineux, tiennent leur rôle avec une virtuosité inégalée.
Réservé via Theatreonline
Encore un délicieux moment à la Comédie Française Par Niamké-Anne G. - 24 juillet 2017 à 09h22
Avec le Français on n'est jamais déçu. Alors en associant Marivaux à l'écriture et Anne Kessler à la mise en scène, c'était le bonheur assuré. Les comédiens sont parfaits, la déco tellement bien pensée, la lecture de la pièce tellement intelligente! Courrez-y ! la meilleure occupation possible par temps de pluie en ce moment, sans doute.
Réservé via Theatreonline
la double inconstance Par JEAN-PIERRE L. - 19 juillet 2017 à 21h28
Très bon spectacle. Acteurs formidables. Mise en scène pleine d'originalité.
Réservé via Theatreonline
Déçu Par Marc B. - 15 juillet 2017 à 17h45
Pour ma part il n'y a qu'Eric Génovèse qui avait une diction digne de la comédie française. On avait de la peine à comprendre ce que disait Silvia. Les couleurs des voix étaient communes. Arlequin est un homme du peuple, il est vrai, mais est-ce une raison de le laisser parler sur un ton lourd et familier. Dans les voix des membres de la cour, sauf Eric Génovèse, il n'y avait ni grâce, ni légèreté, ni distinction, pour moi les rôles n'étaient pas incarnés. Quand je pense à Marivaux, je pense à Watteau. Je n'ai été ni charmé ni ému. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est le confort des sièges de la Comédie-française et la bonne vue sur la scène. C'est peut-être un peu dur mais c'est malheureusement cela.
Par Alain W. - 14 juillet 2017 à 09h55
Gai, surprenant, moderne, sans nuire au texte de Marivaux
Réservé via Theatreonline
Une magnifique soirée Le 10 juillet 2017 à 09h38
J'ai beaucoup apprécié la mise en scène d'Anne Kessler qui fait scintiller de mille feux le texte de Marivaux. Repris une troisième saison pour cause de succès, ce spectacle jeune et inventif convient à toutes les générations. Les comédiens sont à la hauteur de la fausse légèreté de l'auteur. Loïc Corbery, Florence Viala et Adeline d'Hermy sont magnifiques, Stéphane Varupenne est une révélation.
Réservé via Theatreonline
Dommage Par Marina L. - 6 juillet 2017 à 12h41
Mise en scène tantôt féérique et sublime tantôt désagréable de vulgarité. Décor et costume somptueux. Erreur de casting pour certains comédiens, dont certaines éprouvent beaucoup de difficultés à rencontrer l'intemporalité de l'oeuvre de Marivaux. Dommage.
Réservé via Theatreonline
Ennuyeux Par Nathalie N. - 25 octobre 2016 à 15h36
La mise en scène est très ennuyeuse. Pas une idée intéressante, les acteurs portent des lunettes de soleil, ont fait les soldes ( ??) et se promènent avec leurs paquets, c'est ça une touche moderne? Le niveau d'imagination digne d'apprentis de province... Les acteurs ne jouent pas trop mal, mais manquent de peps, pas de personnalité... De plus en plus souvent on a droit à des mises en scène très fades à la Comédie-Française
Réservé via Theatreonline
Moyenne des avis du public - La Double inconstance
Pour 45 Notes
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
La double inconstance Par Christophe B. (1 avis) - 28 juillet 2017 à 12h14
Une mise en scène enjouée, rythmée et virevoltante, qui fait la part belle au texte Marivaux dont on redécouvre avec joie, toute la richesse et la complexité. Extraordinaire mise en abime théâtrale de ce jeu de masques et d'apparences dont la vie nous fait à la fois pour notre plus grand bonheur les complices et victimes consentantes. Bravo aux comédiens du Français qui, dans ce jeu de dupes vertigineux, tiennent leur rôle avec une virtuosité inégalée.
Réservé via Theatreonline
Encore un délicieux moment à la Comédie Française Par Niamké-Anne G. (1 avis) - 24 juillet 2017 à 09h22
Avec le Français on n'est jamais déçu. Alors en associant Marivaux à l'écriture et Anne Kessler à la mise en scène, c'était le bonheur assuré. Les comédiens sont parfaits, la déco tellement bien pensée, la lecture de la pièce tellement intelligente! Courrez-y ! la meilleure occupation possible par temps de pluie en ce moment, sans doute.
Réservé via Theatreonline
la double inconstance Par JEAN-PIERRE L. (4 avis) - 19 juillet 2017 à 21h28
Très bon spectacle. Acteurs formidables. Mise en scène pleine d'originalité.
Réservé via Theatreonline
Déçu Par Marc B. (1 avis) - 15 juillet 2017 à 17h45
Pour ma part il n'y a qu'Eric Génovèse qui avait une diction digne de la comédie française. On avait de la peine à comprendre ce que disait Silvia. Les couleurs des voix étaient communes. Arlequin est un homme du peuple, il est vrai, mais est-ce une raison de le laisser parler sur un ton lourd et familier. Dans les voix des membres de la cour, sauf Eric Génovèse, il n'y avait ni grâce, ni légèreté, ni distinction, pour moi les rôles n'étaient pas incarnés. Quand je pense à Marivaux, je pense à Watteau. Je n'ai été ni charmé ni ému. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est le confort des sièges de la Comédie-française et la bonne vue sur la scène. C'est peut-être un peu dur mais c'est malheureusement cela.
Par Alain W. (1 avis) - 14 juillet 2017 à 09h55
Gai, surprenant, moderne, sans nuire au texte de Marivaux
Réservé via Theatreonline
Une magnifique soirée Le 10 juillet 2017 à 09h38
J'ai beaucoup apprécié la mise en scène d'Anne Kessler qui fait scintiller de mille feux le texte de Marivaux. Repris une troisième saison pour cause de succès, ce spectacle jeune et inventif convient à toutes les générations. Les comédiens sont à la hauteur de la fausse légèreté de l'auteur. Loïc Corbery, Florence Viala et Adeline d'Hermy sont magnifiques, Stéphane Varupenne est une révélation.
Réservé via Theatreonline
Dommage Par Marina L. (2 avis) - 6 juillet 2017 à 12h41
Mise en scène tantôt féérique et sublime tantôt désagréable de vulgarité. Décor et costume somptueux. Erreur de casting pour certains comédiens, dont certaines éprouvent beaucoup de difficultés à rencontrer l'intemporalité de l'oeuvre de Marivaux. Dommage.
Réservé via Theatreonline
Ennuyeux Par Nathalie N. (2 avis) - 25 octobre 2016 à 15h36
La mise en scène est très ennuyeuse. Pas une idée intéressante, les acteurs portent des lunettes de soleil, ont fait les soldes ( ??) et se promènent avec leurs paquets, c'est ça une touche moderne? Le niveau d'imagination digne d'apprentis de province... Les acteurs ne jouent pas trop mal, mais manquent de peps, pas de personnalité... De plus en plus souvent on a droit à des mises en scène très fades à la Comédie-Française
Réservé via Theatreonline
Magnifique Le 13 février 2016 à 18h57
De la mise en scène à la fois fidèle et pleine d'inventivité au jeu d'acteurs et bien sûr à la pièce elle-même, tout était magnifique. Un vrai plaisir. Merci à eux !
Réservé via Theatreonline
Double Inconstance...Déception Par Julie L. (1 avis) - 10 février 2016 à 23h57
Les acteurs déclament tels des machines plus qu'ils ne jouent, manque de nuance dans l'interprétation, décevant pour des acteurs de la comédie francaise dont on attend l'excellence... La mise en scène est une juxtaposition d'idées hétéroclites qui ne servent pas un objectif clair, et donnent plutot l'impression que le metteur en scène se fait plaisir, au lieu d'essayer de donner du sens... Seule Catherine Salviat nous offre un instant de répit et de grâce avec sa magnifique interprétation du Seigneur, ouf !
Réservé via Theatreonline
Double inconstance Par BRIGITTEV (4 avis) - 10 février 2016 à 15h49
Un vrai régal que ce spectacle ! La pièce de Marivaux a été brillamment mise en scène .
Réservé via Theatreonline
Double inconstance Par Mario S. (1 avis) - 7 février 2016 à 10h28
Excellents acteurs. Mise en scène somptueuse. Marivaux est d'actualité. Le bal des "faux culs ". Un vrai régal.
Réservé via Theatreonline
La double inconstance Par SYLVIE B. (1 avis) - 4 février 2016 à 10h03
Mise en scène moderne, plaisante et originale qui sied bien à la pièce. Les acteurs parlent parfois trop vite et donc on perd un peu le subtil texte de Marivaux. Superbe soirée ! Allez-y!
Réservé via Theatreonline
La double inconstance Par Nicole V. (1 avis) - 31 janvier 2016 à 22h04
Du premier balcon face, Silvia était très difficilement audible, débit trop rapide et voix trop faible ! Dommage
La double inconstance Par Claire S. (1 avis) - 22 janvier 2016 à 15h36
Belle mise en scène, beaucoup d'émotion et de vivacité. Débit peut-être un peu rapide des acteurs.
Réservé via Theatreonline
Informations pratiques - Comédie-Française - Salle Richelieu
Comédie-Française - Salle Richelieu
Place Colette 75001 Paris
- Métro : Palais Royal - Musée du Louvre à 138 m (1/7), Pyramides à 271 m (7/14)
- Bus : Palais Royal - Comédie Française à 40 m, Palais Royal - Musée du Louvre à 86 m, Bibliothèque Nationale à 396 m
Plan d’accès - Comédie-Française - Salle Richelieu
Place Colette 75001 Paris