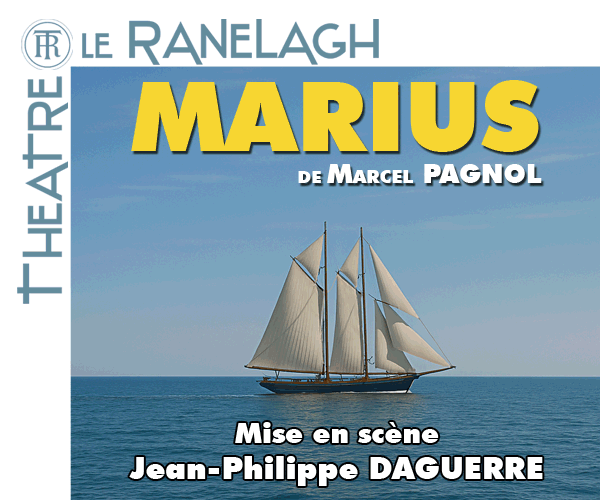Anéantis
Anéantis
- De : Sarah Kane
- Mise en scène : Daniel Jeanneteau
- Avec : Gaël Baron, Stéphanie Schwartzbrod, Gérard Watkins
« Nous devons parfois descendre en enfer par l’imagination pour éviter d’y aller dans la réalité. »
Un cadeau d'amour
La forme est le sens - entretien avec Sarah Kane
Une forme de civisme - entretien avec Daniel Jeanneteau
« J'ai été stupéfaite de ces clameurs d'épouvante qui ont éclaté à propos de mes pièces, parce qu'en fin de compte il ne s'agit pas de brutalité ou de cruauté. Elles sont là, sans plus, quand on écrit et qu'en dépit de toute la violence qui existe, on veut continuer d'aimer et d'espérer. » Sarah Kane
La première violence de la découverte, l'effet de mode, sont maintenant passés. On peut commencer à voir Sarah Kane autrement, avec moins de fascination ou de dégoût, comme un être visionnaire, frappé de lucidité, et généreux. On peut sortir son œuvre du registre de la provocation, qui personnellement ne m'intéresse pas. Qui ne l'intéressait pas non plus elle-même. Contre toute attente elle était sincère, et, comment le dire autrement, aimante.
Son œuvre, définitivement close en cinq textes exigeants et beaux, est un cadeau d'amour, pour reprendre la formule de Bruno Bettelheim à propos des contes de fées. C'est à dire que, aimante, elle nous risque à la plus radicale des expériences, non par haine ou par goût du sang, mais parce que l'humain se définit précisément par son besoin et sa capacité de se confronter au pire.
La lecture il y a quelques années de L'Espèce humaine de Robert Antelme m'a révélé cela : loin de m'affliger, de m'atteindre en m'enlevant des forces, le regard qu'Antelme porte sur son expérience dans les camps de concentration, échappant à la fatalité de l'état de victime et envisageant l'humain dans son unité indivisible, restaure, étrangement, une forme de confiance que je pensais avoir perdue. Il y a là, dans l'expérience même du désastre, comme un rappel à l'humain.
« Nous devons parfois descendre en enfer par l’imagination pour éviter d’y aller dans la réalité. » disait Sarah Kane. De même Andersen prend les enfants par la main de leur imagination pour les amener à vivre les pires choses, dans la parenthèse du conte. Hölderlin disait du poète qu'il saisit de sa main le terrible, l'éclair lui-même, pour le tendre aux foules sous son voile de chant. Anéantis, comme l'ensemble de l'œuvre de Sarah Kane, est un poème et un conte. Complexe, douloureux, charriant des blocs de réalité opaques, mais avant tout un poème. Pas un simulacre, mais la réalité rejointe par les figures de l'art. Les scènes, les gestes n'y sont pas documentaires, mais images, et, comme images, agissantes, suscitant la réalité par d'autres moyens que ceux de l'imitation.
La problématique centrale d'un tel texte est évidemment celle de la représentation. Que ce soit pour le jeu des acteurs comme pour la scénographie. Comment représenter la violence physique ou le sexe ? Comment négocier, dans le décor, la convention de la chambre à coucher, le mini-bar, la salle de bain, et la violence métaphysique de l'explosion ? Dans ces deux domaines je n'ai pas de réponses préconçues ; mais c'est précisément cette difficulté, abrupte, qui m'attire, et qui exige de nous l'invention d'une forme et d'un langage théâtral que nous ne connaissons pas encore.
À la création Anéantis a scandalisé le public et la critique, parce que selon Sarah Kane sa pièce « faisait apparaître un lien direct entre la violence domestique en Angleterre et la guerre civile dans l'ancienne Yougoslavie. Elle posait la question : Quel est le rapport entre un viol ordinaire commis à Leeds et le viol en masse utilisé comme arme de guerre en Bosnie ? Et la réponse semblait être que le rapport est très étroit. L'unité de lieu évoque l'idée d'un simple mur de papier qui séparerait la sécurité et la civilisation de l'Angleterre tranquille de la violence et du chaos de la guerre civile. Un mur qui pourrait être déchiré, sans prévenir, à tout moment. »
Comment ne pas penser à la déchirure du 11 septembre, et aux mille déflagrations, encore discrètes, qui travaillent la société occidentale.
Daniel Jeanneteau
Traduction française de Lucien Marchal.
Avez-vous été surprise de l'attention que les médias ont accordée à Anéantis
?
Oui. La semaine où le spectacle a commencé, il y a eu un tremblement de terre au Japon, où des milliers de gens ont péri, et, dans ce pays, une jeune fille de quinze ans a été violée et assassinée dans un bois. Mais Anéantis a eu une couverture plus importante dans certains journaux que l'un ou l'autre de ces événements. [...]
Mais il y a bien plus important que le contenu de la pièce, c'est-à-dire la forme. Tout art de qualité est subversif, dans sa forme ou dans son contenu. Et l'art le plus grand est subversif dans sa forme et dans son contenu. Et souvent, la forme est l'élément qui fait le plus injure à ceux qui veulent imposer la censure. Beckett, Barker, Pinter, Bond, ils ont tous été critiqués non tant pour le contenu de leur œuvre que parce qu'ils utilisaient des formes non naturalistes qui se dérobaient à une interprétation simpliste. Je pense que si Anéantis avait été une oeuvre de réalisme social, elle n'aurait pas été accueillie aussi durement. La forme et le contenu tentent d'être une seule et même chose – la forme est le sens. La tension de la première moitié de Anéantis – cette effroyable tension sociale, psychologique et sexuelle – est presque une prémonition du désastre à venir. Et quand il a lieu, la structure de la pièce se fracture pour le laisser entrer. La pièce s'effondre dans une des crises du personnage de Cate. La forme est directement parallèle à la vérité de la guerre qu'elle décrit – une forme traditionnelle est soudainement et violemment interrompue par l'irruption d'un élément inattendu qui sans explication logique entraîne les personnages et la pièce dans une dépression chaotique [...]
L'indignation soulevée par les images présentées ne provenait pas de l'idée que de telles choses aient réellement lieu, mais du fait d'être amené à considérer l'idée tout en regardant ces images. Le choc n'était pas suscité par le contenu mais plutôt par le fait que l'ordinaire soit réarrangé de manière qu'on puisse le voir avec un autre regard. Le cannibalisme en direct sur scène faisait hurler la presse, quand, bien sûr, il ne s'agissait pas de monter aux spectateurs des atrocités réelles, mais la réponse imaginaire que proposait une forme théâtrale étrange face à ces atrocités, avec une structure apparemment brisée et schizophrénique, qui présentait un matériau sans commentaire et demandait au public de se fabriquer sa propre réponse. La représentation de la violence a provoqué plus de fureur que la violence réelle. Tandis que le cadavre de la Yougoslavie pourrissait au seuil de notre porte, la presse choisissait de se mettre en colère, non pas face à l'existence du cadavre, mais face à l'événement culturel qui avait attiré l'attention sur lui. [...]
Un critique a soulevé une question importante en regard de votre travail : « Combien de désespoir peut-on communiquer et combien d'horreurs peut-on montrer, avant que le public ne fasse une overdose ? »
La plupart des gens font l'expérience d'un désespoir et d'une brutalité plus grands encore. Le même danger d'overdose existe au théâtre et dans la vie. On choisit de le représenter ou de ne pas le représenter. J'ai choisi de le représenter parce que nous devons parfois descendre en enfer par l'imagination pour éviter d'y aller dans la réalité. Si, par l'art, nous pouvons expérimenter quelque chose, nous pourrions peut-être devenir capables de changer notre avenir ; l'expérience de la souffrance imprime en nous les marques de ses leçons, tandis que la spéculation nous laisse intacts. [...] Il me paraît crucial d'établir la chronique et d'enregistrer la mémoire d'événements jamais encore expérimentés - pour éviter qu'ils aient lieu. Je préfère risquer 1'overdose au théâtre que dans la vie. Et je préfère prendre le risque de susciter des réactions de défense violentes plutôt que d'appartenir passivement à une civilisation qui s'est suicidée.
Extrait de « Sarah Kane », in Heidi Stephenson et Natasha Langridge,
Rage and Reason, Women Playwrighis on Playwriting, Methuen Drama, Londres, 1997
Sarah Kane ne voulait pas qu'on prenne ses indications au pied de la lettre. Elle était étonnamment prude à propos de son oeuvre. Elle ne voulait pas que le public voit des pipes ou des mutilations ; pour elle, c'était des images. Elle avait jugé cynique la mise en scène d'Anéantis à Berlin. Elle l'avait trouvée choquante, branchée et stylisée, à l'image du cinéma de Tarantino qu'elle détestait. Ils avaient pris la pièce au pied de la lettre et la nudité y était trop présente. C'était fidèle au texte, mais ça manquait de sens métaphorique, de poésie, et elle trouvait cela détestable.
D'après Nils Tabert, traducteur allemand de Sarah Kane
[…]
A. D. L. – La première pièce de Sarah Kane, Anéantis, semble très inspirée par le théâtre d’Edward Bond : elle a dit qu’elle avait été particulièrement choquée par la lapidation du bébé dans
Sauvés et que cela lui avait fait comprendre que « nous devons parfois descendre en enfer par l’imagination pour éviter d’y aller dans la réalité ».
D. J. - Avec Anéantis Sarah Kane a cherché à témoigner de l’état de l’humanité contemporaine : par un travail de condensations et de raccourcis, elle a rassemblé sur trois figures quelque chose du désastre de la guerre en Bosnie, dans une sorte de parabole qui s’apparente à la tragédie. L’univers clos, sécurisé des sociétés occidentales ne pourra pas toujours se protéger de la détresse, de la violence du monde extérieur. D’autant plus que l’action de l’Occident sur les sociétés « extérieures » est elle-même d’une grande violence. Je crois que Sarah Kane avait une conscience très crue
- dont elle souffrait - de tous les déséquilibres, de toutes les catastrophes en cours.
Anéantis était un peu une tentative de faire éprouver au public, dans le temps d’une représentation, quelque chose de la situation mondiale, de la dégradation des valeurs d’humanité, de toutes les déviances dans les relations humaines, particulièrement entre hommes et femmes. Dans une chambre d’hôtel de luxe, une adolescente, jeune fille-enfant, Cate, est victime et compagne d’une sorte d’amant pédophile qu’elle essaie d’aimer. Le personnage de la jeune fille est ambigu et vraiment magnifique, dans la mesure où il rassemble en lui plusieurs figures superposées : l’enfant abusé, la femme comme objet de désir, aussi bien que toute la force, toute la capacité de résistance et de subversion du féminin dans une société dominée par les valeurs masculines. Cate est confrontée à des figures du masculin, qui, à mon avis, synthétisent l’effondrement d’une société arrivant à épuisement : la société masculine occidentale basée sur la domination. Or, de tous ces énoncés, qui pourraient paraître assez banals, elle parvient à tirer le feu d’une véritable brûlure.
A. D. L. - La violence y devient tellement exceptionnelle, tellement inouïe, qu’on rentre dans un univers déréalisé, fantastique, presque métaphysique. D’ailleurs même si
Anéantis fait allusion à la guerre en Bosnie, Purifiés au nazisme et au massacre des juifs, Kane tient à souligner que, dans ses textes, elle essaie toujours d’éviter la mise en relation concrète avec les faits réels. Dans ses œuvres la partie du fantasme, du fantastique, est très importante, sinon prépondérante.
D. J. - Oui, les repères sont tellement détruits, perturbés, déplacés qu’on arrive à un univers proche de celui de Beckett, qui est aussi un univers du désastre, un univers de la perte de tout sens et de la fin de toutes les illusions qui permettent de se maintenir dans la durée d’une existence. L’expérience du désastre permet de se placer à un endroit où la pensée, l’expérience vécue, sensuelle, sensorielle et intellectuelle atteint une dimension philosophique plus vaste, plus abstraite, projetée hors des rails normaux. C’est justement ce dépassement des limites qui suscite, par la transgression, une pensée vivante, une subversion. Mais ce que je dis là, je ne le pensais pas au départ : le premier texte qu’en fait j’avais lu d’elle, il y a déjà longtemps, était
L’Amour de Phèdre, et je l’ai détesté. Je l’avais pris au premier degré, comme une démonstration violente et insupportable, complaisante, de ce qu’il peut y avoir de pire dans une société qui dégénère : une espèce de laisser-aller pénible, où le sexe est perverti au nom de la liberté de détruire. C’est effectivement ce qu’elle montre : mais elle utilise ce pourrissement, cette déchéance des valeurs humaines pour les mettre au service d’un autre projet, d’une dénonciation radicale ; il n’y a pas d’identification, il n’y a pas de goût pour la violence ni pour la provocation, il n’y a pas de complaisance. Je pense même qu’il y a une forme de civisme de sa part, de nécessité très honnête et, en même temps, pleine de détresse. Il n’est plus possible aujourd’hui d’écrire du théâtre qui ait pour ambition de parler du monde sans rendre compte de cette violence, de ce pourrissement, de cet appauvrissement, de cet épuisement… En mettant Hippolyte « sous perfusion télévisuelle », dans une espèce de régression profonde dont il est conscient, Kane montre le suicide collectif de notre civilisation. L’attitude d’Hippolyte est évidemment suicidaire. Il y a une telle haine de soi dans ce personnage, une telle pratique du pire, un tel désir d’avilissement personnel et de tous ceux qui l’approchent, que son exemplarité pose la question de l’Occident tout entier.
[…]
A. D. L. - En tant qu’écrivain, Kane se donnait la responsabilité d’affronter la vérité, fût-ce au prix de se risquer sur des terrains inconnus, de se frotter aux limites de l’humain et d’expérimenter de nouvelles formes pour essayer de changer et d’élargir notre perception du monde : elle croit fortement au pouvoir du théâtre en tant que moyen de connaissance et de transformation…
D. J. - Cela me fait penser aussi à Strindberg, et particulièrement à La Sonate des spectres dont elle s’est inspirée pour écrire
Purifiés. Strindberg était quelqu’un qui n’arrivait pas - il le dit dans ses lettres
- à écrire des choses belles, agréables, qui puissent distraire. Il était atteint de lucidité, affligé d’un regard sans protection sur le monde. Il ne pouvait pas arranger la réalité. Il ne pouvait pas se raconter des histoires. Il s’en est sorti en écrivant beaucoup, en donnant forme dans son œuvre à toute sa douleur, et aussi à toute sa haine, à tout son dégoût : même s’il a écrit des choses épouvantables, il l’a toujours fait avec cette espèce de constructivité, de positivité, de bonne foi naïve qui cherchait à mettre en forme ce qui n’a pas de forme. Rien n’est pire, rien n’est plus destructeur que de fuir ces réalités et de les nier, ou d’essayer de les oublier. Edgar Morin a développé cette idée dans le livre
Terre-Patrie, où il dit que la catastrophe est le destin inévitable du monde humain et du cosmos, voués à plus ou moins long terme à la désintégration. Que le monde se constitue dans le temps même de sa désintégration, comme nous l’apprend l’astrophysique. Dans un chapitre qu’il a intitulé « L’Évangile de la perdition », Edgar Morin appelle à prendre conscience du fait que toute existence est en route vers sa fin, que les religions ont été inventées pour répondre, tout du moins illusoirement, au problème de la mort par une hypothétique vie après la mort, mais que si nous prenions pleinement conscience de cette perdition en cours, si nous l’acceptions comme la base, comme la condition même de notre vie, nous pourrions établir les fondements d’un nouveau rapport à l’existence : il faut pratiquer cette pensée de la perdition comme on a pratiqué, pendant des siècles, la pensée du Salut et de la survie après la mort.
L’intégralité de cet entretien est publiée dans OutreScène n°1, février 2003
Propos recueillis par Angela De Lorenzis en décembre 2002
Sélection d'avis des spectateurs - Anéantis
Anéantis Le 13 avril 2005 à 12h46
Fort très fort ! Attention préparez-vous au choc émotionnel car la mise en scène de Jeanneteau est époustouflante, les comédiens... des dieux vivants ! Un don pour le Théâtre.
Vous avez vu ce spectacle ? Quel est votre avis ?
Anéantis Le 13 avril 2005 à 12h46
Fort très fort ! Attention préparez-vous au choc émotionnel car la mise en scène de Jeanneteau est époustouflante, les comédiens... des dieux vivants ! Un don pour le Théâtre.
Informations pratiques - TGP - CDN de Saint-Denis
TGP - CDN de Saint-Denis
59, boulevard Jules Guesde 93207 Saint-Denis
- Métro : Basilique de Saint-Denis à 666 m (13)
- RER : Saint-Denis à 534 m (D)
- Tram : Théâtre Gérard Philipe à 89 m (T1), Saint-Denis - Gare à 387 m (T8), Marché de Saint-Denis à 395 m (T1/T5)
- Bus : Église - Théâtre Gérard Philipe à 265 m, Marché de Saint-Denis à 361 m
- Transilien : Saint-Denis à 534 m (H)
-
Voiture : Depuis Paris : Porte de la Chapelle - Autoroute A1 - sortie n°2 Saint-Denis centre (Stade de France), suivre « Saint-Denis centre ». Contourner la Porte de Paris en prenant la file de gauche. Continuer tout droit puis suivre le fléchage « Théâtre Gérard Philipe » (emprunter le bd Marcel Sembat puis le bd Jules Guesde).
Plan d’accès - TGP - CDN de Saint-Denis
59, boulevard Jules Guesde 93207 Saint-Denis